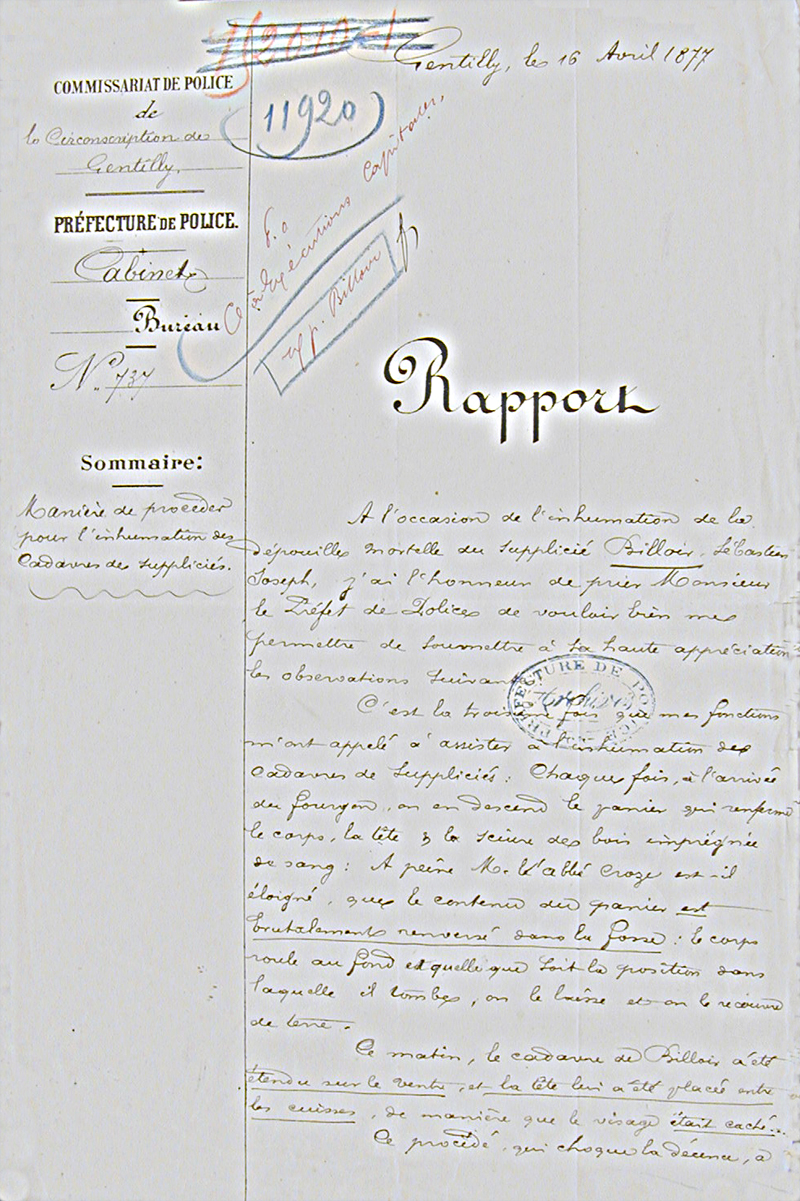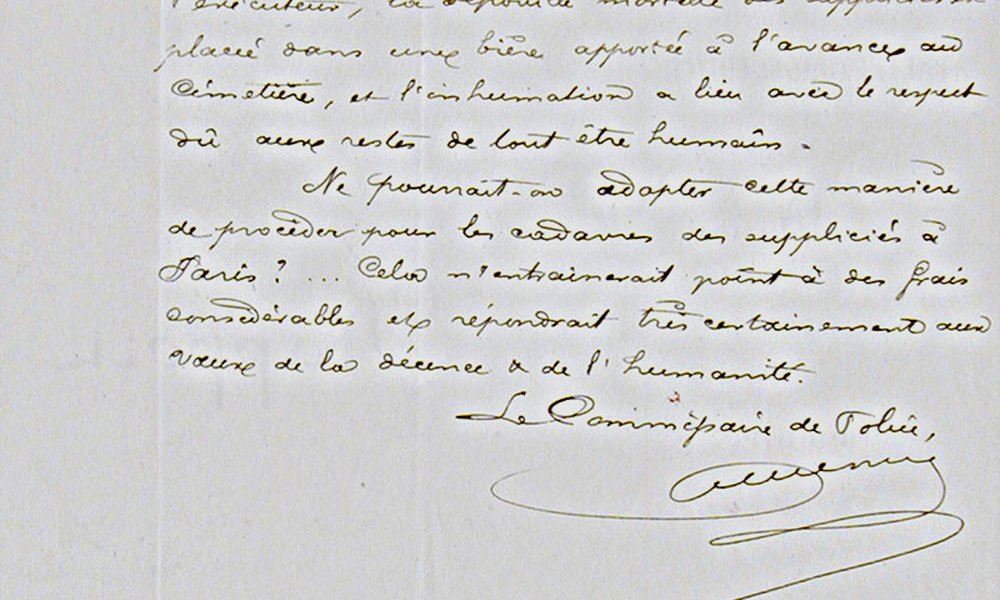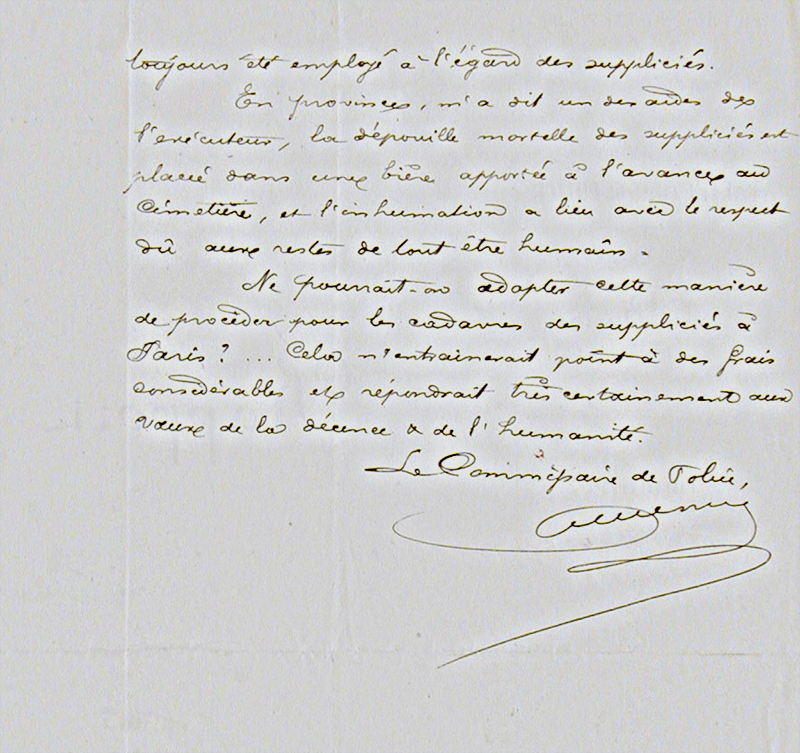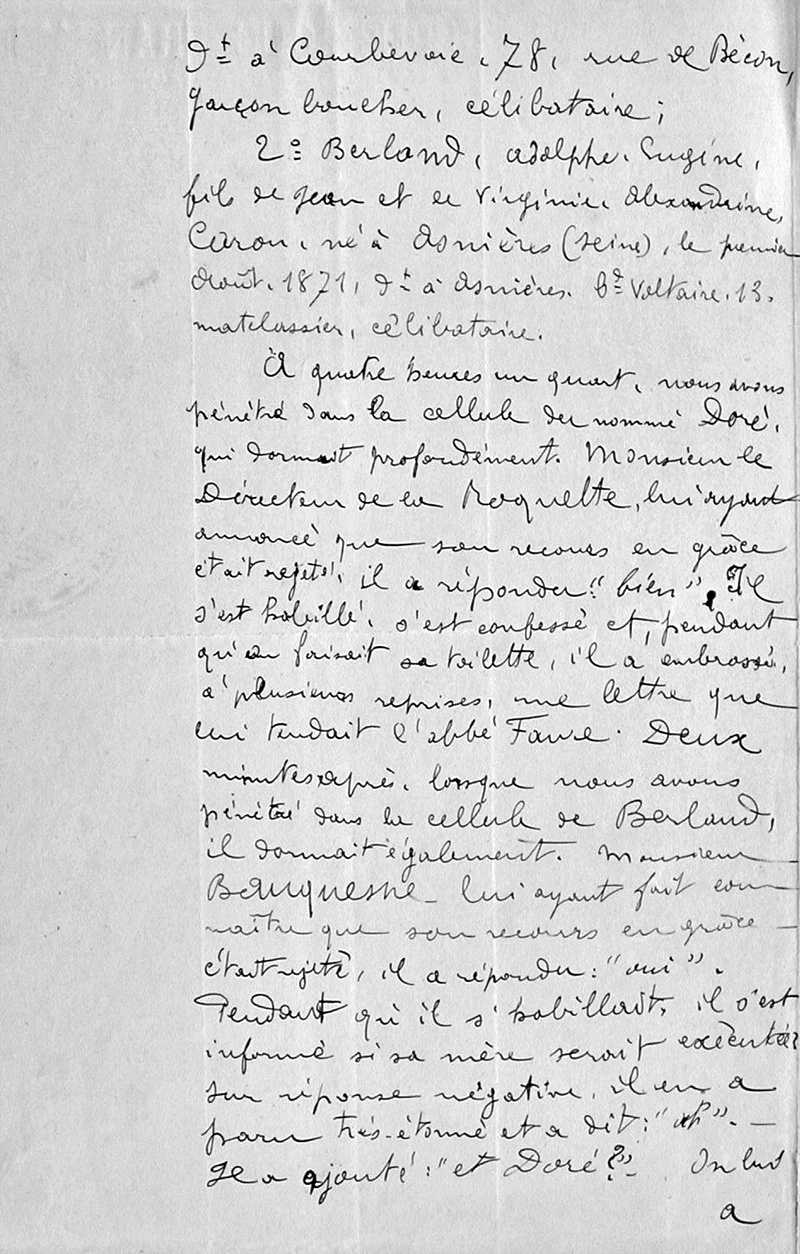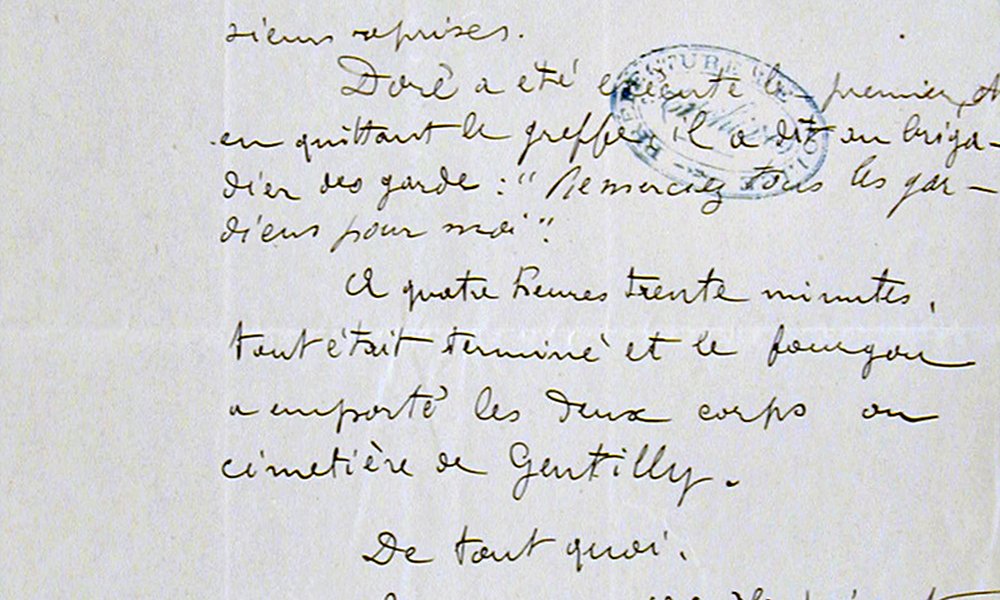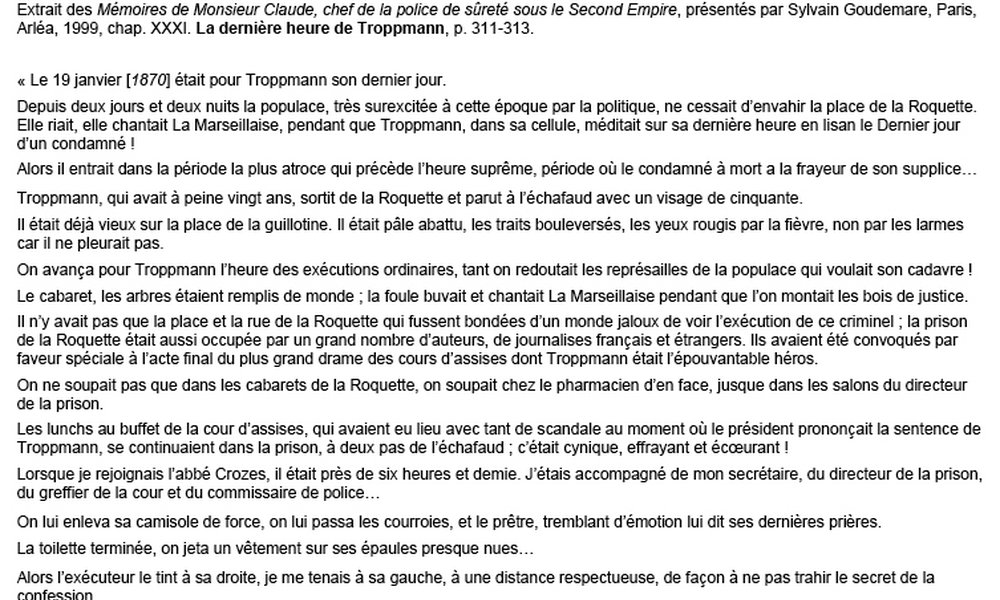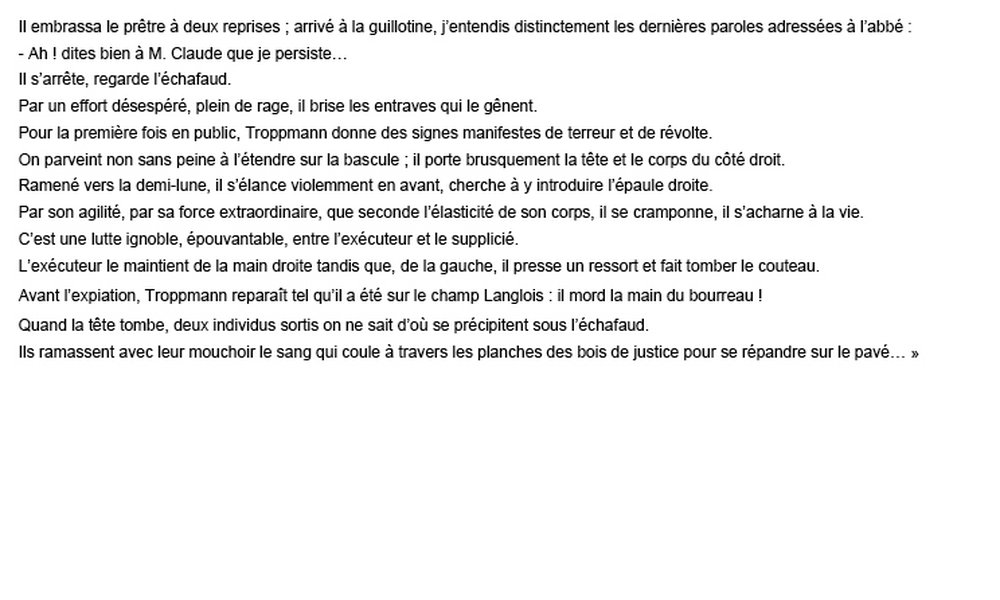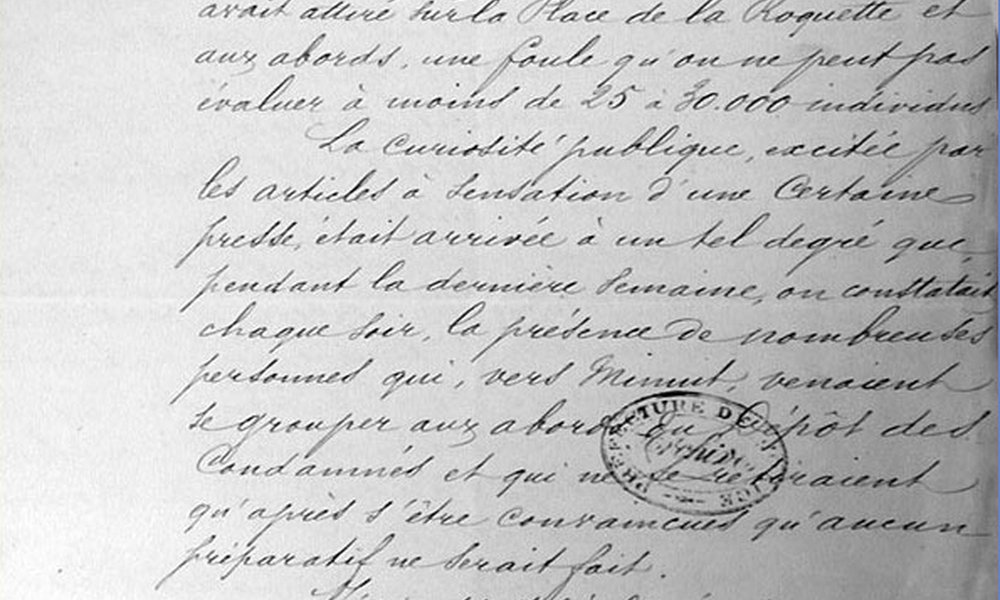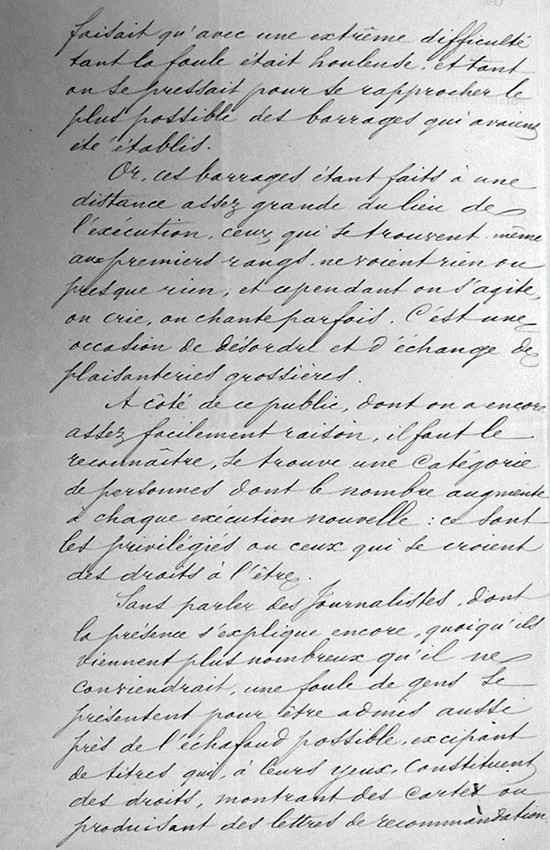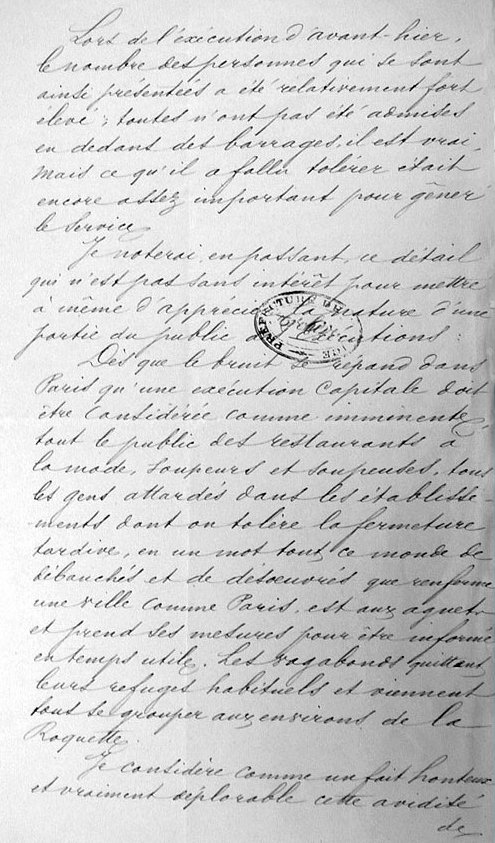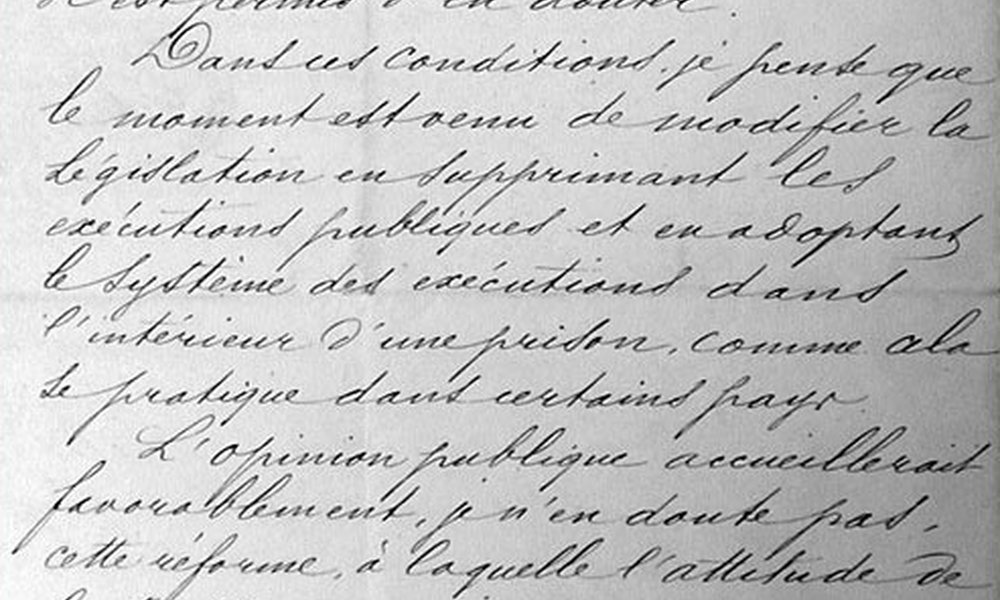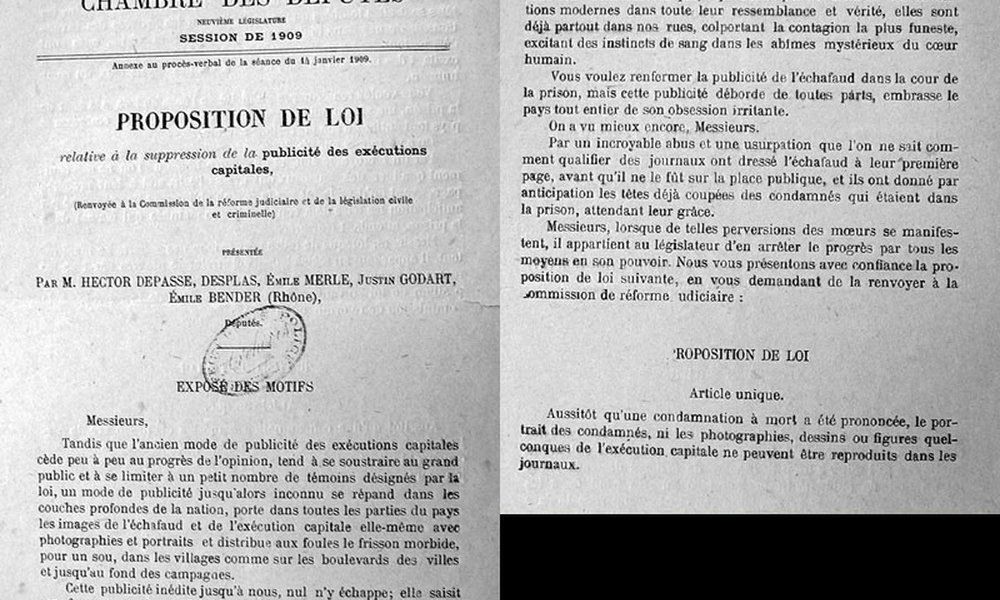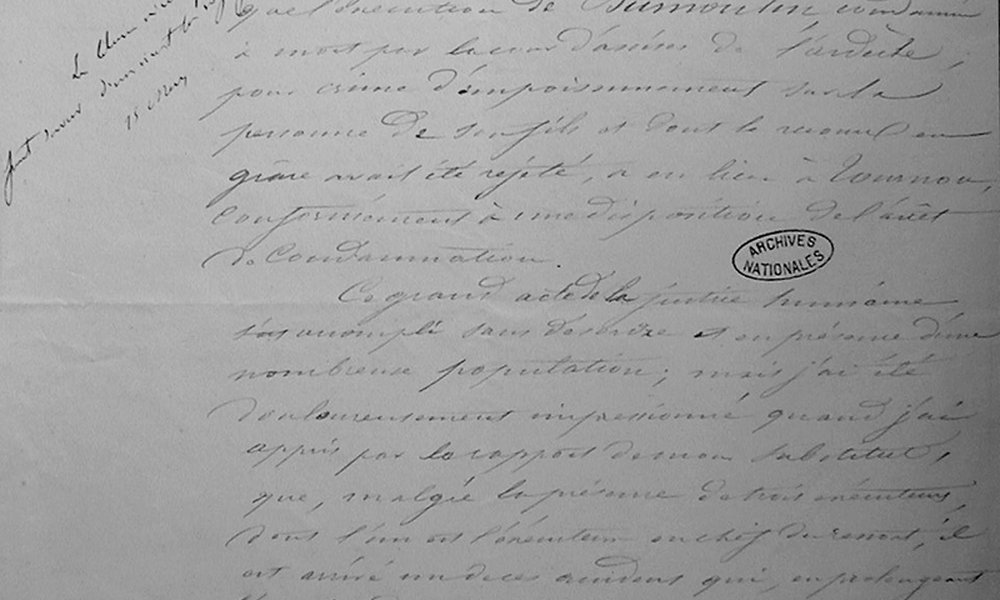Le scandale de l’exécution de Montcharmont (1851)
Source : Le Courrier de Saône-et-Loire, 10 mai 1851.
Le Courrier de Saône-et-Loire, 10 mai 1851. Claude Montcharmont, un taillandier et braconnier de Saint-Prix, dans le Morvan, avait tué un garde-chasse et un gendarme en novembre 1850. Bénéficiant de la complicité des gens de son village (un habitant aurait dit à propos de l’un des crimes : « ce n’est qu’un bourreau qui en a tué un autre »), il n’est arrêté qu’un mois plus tard, et la cour d’assises de Saône-et-Loire le condamne le 29 mars 1851 à la peine de mort. La révolte de Montcharmont sur l’échafaud est telle que l’exécution doit être remise au lendemain. Le journal cité du département, considérant la peine comme entièrement justifiée pour cet assassin qui a « terrorisé » tout un arrondissement, ne peut taire son sentiment d’horreur devant un tel spectacle. Le scandale causé par cette exécution trouve un écho dans la presse nationale et Charles Hugo fustige dans L'Evénement le comportement d'une justice coupable de tels excès. Traduit devant les assises de la Seine pour ce délit de presse, le 11 juin 1851, il est défendu par son père qui plaide en faveur de l'abolition. Il évoque ainsi l'exécution du malheureux braconnier du Morvan : « Mais le ministère public, c’est là son second argument, prétend que la critique de l’Événement a été trop loin, a été trop vive. Ah ! vraiment, messieurs les jurés, le fait qui a amené ce prétendu délit qu’on a le courage de reprocher au rédacteur de l’Événement, ce fait effroyable, approchez-vous-en, regardez-le de près. Quoi ! un homme, un condamné, un misérable homme, est traîné un matin sur une de nos places publiques ; là, il trouve l’échafaud. Il se révolte, il se débat, il refuse de mourir. Il est tout jeune encore, il a vingt-neuf ans à peine... – Mon Dieu ! je sais bien qu’on va me dire C’est un assassin ! Mais écoutez !... – Deux exécuteurs le saisissent, il a les mains liées, les pieds liés, il repousse les deux exécuteurs. Une lutte affreuse s’engage. Le condamné embarrasse ses pieds garrottés dans l’échelle patibulaire, il se sert de l’échafaud contre l’échafaud. La lutte se prolonge, l’horreur parcourt la foule. Les exécuteurs, la sueur et la honte au front, pâles, haletants, terrifiés, désespérés, – désespérés de je ne sais quel horrible désespoir, – courbés sous cette réprobation publique qui devrait se borner à condamner la peine de mort et qui a tort d’écraser l’instrument passif, le bourreau (mouvement), les exécuteurs font des efforts sauvages. Il faut que force reste à la loi, c’est la maxime. L’homme se cramponne à l’échafaud et demande grâce. Ses vêtements sont arrachés, ses épaules nues sont en sang ; il résiste toujours. Enfin, après trois quarts d’heure, trois quarts d’heure !... (Mouvement. M. l’avocat général fait un signe de dénégation. M. Victor Hugo reprend.) – On nous chicane sur les minutes : trente-cinq minutes, si vous voulez ! – de cet effort monstrueux, de ce spectacle sans nom, de cette agonie, agonie pour tout le monde, entendez-vous bien ? agonie pour le peuple qui est là autant que pour le condamné, après ce siècle d’angoisse, messieurs les jurés, on ramène le misérable à la prison. Le peuple respire. Le peuple, qui a des préjugés de vieille humanité, et qui est clément parce qu’il se sent souverain, le peuple croit l’homme épargné. Point. La guillotine est vaincue, mais elle reste debout. Elle reste debout tout le jour, au milieu d’une population consternée. Et, le soir, on prend un renfort de bourreaux, on garrotte l’homme de telle sorte qu’il ne soit plus qu’une chose inerte, et, à la nuit tombante, on le rapporte sur la place publique, pleurant, hurlant, hagard ; tout ensanglanté, demandant la vie, appelant Dieu, appelant son père et sa mère, car devant la mort cet homme était redevenu un enfant. (Sensation.) On le hisse sur l’échafaud, et sa tête tombe ! – Et alors un frémissement sort de toutes les consciences. Jamais le meurtre légal n’avait apparu avec plus de cynisme et d’abomination. Chacun se sent, pour ainsi dire, solidaire de cette chose lugubre qui vient de s’accomplir, chacun sent au fond de soi ce qu’on éprouverait si l’on voyait en pleine France, en plein soleil, la civilisation insultée par la barbarie. C’est dans ce moment-là qu’un cri échappe à la poitrine d’un jeune homme, à ses entrailles, à son coeur, à son âme, un cri de pitié, un cri d’angoisse, un cri d’horreur, un cri d’humanité ; et ce cri, vous le puniriez ! Et, en présence des épouvantables faits que je viens de remettre sous vos yeux, vous diriez à la guillotine : Tu as raison ! et vous, diriez à la pitié, à la sainte pitié : Tu as tort ! » Pour en savoir plus : Bibliographie sur le site Criminocorpus et le texte complet de la plaidoirie de Victor Hugo aux assises de la Seine le 11 juin 1851 sur le site Victor Hugo contre la peine de mort de Danielle Girard (académie de Rouen).
Le scandale de l’exécution de Montcharmont (1851) (suite)
Source : Le Courrier de Saône-et-Loire, 10 mai 1851.Au carré des suppliciés
Source : Archives de la préfecture de police de Paris, BA/887.
Rapport du commissaire de police de Gentilly sur la manière de procéder pour l’inhumation des cadavres des suppliciés, 16 avril 1877 (Archives de la préfecture de police de Paris, BA/887) Sébastien-Joseph Billoir a été condamné à mort par la cour d’assises de la Seine le 15 mars 1876, pour avoir tué et dépecé une femme à Saint-Ouen. Le jour même de l’exécution, le commissaire de Gentilly qui a en charge la surveillance du « carré des suppliciés » du cimetière de Gentilly, rédige ce rapport dans lequel il fustige la pratique « indécente » des exécuteurs parisiens qui ne prennent aucun soin du cadavre lors de l’inhumation, et jetant les restes du supplicié dans une fosse comme ils viennent, et plaçant la tête entre les cuisses… Le rapport se veut plus rassurant sur la pratique provinciale de l’inhumation des condamnés à mort. Il suffit pourtant de lire le premier chapitre de Tu ne tueras pas d’Albert Naud pour constater qu’en la matière, la décence n’est pas encore au rendez-vous, en 1951, à Arras. À noter que le rapport n’évoque pas la pratique courante des médecins de demander l'autorisation de recueillir le cadavre à fins d'expériences diverses.
Au carré des suppliciés (suite)
Source : Archives de la préfecture de police de Paris, BA/887.De la place de la Grève à la Roquette
Source : Extrait d’Alexandre Dumas, Mes Mémoires, chap. 222.
Extrait d’Alexandre Dumas, Mes Mémoires, chap. 222. Dans la capitale, sous l’ancien régime, les exécutions publiques avaient lieu sur plusieurs places, la place de la Grève étant la plus prisée, car située au cœur de la cité, à proximité de l’Hôtel de ville. Elle l’est encore après la Révolution, dans les premières années du XIXe siècle. Mais au lendemain de la révolution 1830, le « sang versé » par les combattants des journées de Juillet qui ont renversé le régime de Charles X sert d’argument pour éloigner du « centre de Paris » le lieu des exécutions qui se déroulent, à partir de 1832, à la périphérie, place de la barrière Saint-Jacques. Mais le trajet de la prison au supplice en devient beaucoup plus long, surtout quand, à partir de 1836, il faut parcourir cinq kilomètres de La Grande Roquette à la barrière Saint-Jacques. Dans un souci d’humanité, mais également en accord avec la sensibilité des élites auxquelles le spectacle de la mise à mort répugne, un décret du 29 novembre 1851 fixe le lieu d’exécution à l’entrée de la Grande Roquette : 69 condamnés à mort y seront guillotinés jusqu’en 1899, année où la prison est désaffectée. L’exécution se déroule ensuite à la porte de la prison de la Santé où se trouve dorénavant le dépôt des condamnés à mort : la première, celle du parricide Duchemin a lieu en 1909. Le transfert de la place de la Grève à la périphérie de la ville - les « barrières », en l'occurrence la barrière Saint-Jacques - a une valeur symbolique, rapidement mise en valeur par les adversaires de la peine capitale qui interprètent ce transfert comme une façon de cacher la guillotine... Victor Hugo, dans la préface (1832) du Dernier jour d'un condamné tire argument du rejet de la guillotine aux confins des murs de la ville : « À Paris, nous revenons au temps des exécutions secrètes. Comme on n'ose plus décapiter en Grève depuis juillet, comme on a peur, comme on est lâche, voici ce qu'on fait. On a pris dernièrement à Bicêtre un homme, un condamné à mort, un nommé Désandrieux, je crois ; on l'a mis dans une espèce de panier traîné sur deux roues, clos de toutes parts, cadenassé et verrouillé ; puis, un gendarme en tête, un gendarme en queue, à petit bruit et sans foule, on a été déposer le paquet à la barrière déserte de Saint-Jacques. Arrivés là, il était huit heures du matin, à peine jour, il y avait une guillotine toute fraîche dressée et pour public quelque douzaine de petits garçons groupés sur les tas de pierres voisins autour de la machine inattendue ; vite, on a tiré l'homme du panier, et, sans lui donner le temps de respirer, furtivement, sournoisement, honteusement, on lui a escamoté sa tête. Cela s'appelle un acte public et solennel de haute justice. Infâme dérision ! » Il reprend cet argument au procès de son fils Charles, devant la Cour d'assises de la Seine en 1851 : « Je croyais, dis-je, que la guillotine, puisqu’il faut l’appeler par son nom, commençait à se rendre justice à elle-même, qu’elle se sentait réprouvée, et qu’elle en prenait son parti. Elle avait renoncé à la place de Grève, au plein soleil, à la foule, elle ne se faisait plus crier dans les rues, elle ne se faisait plus annoncer comme un spectacle. Elle s’était mise à faire ses exemples le plus obscurément possible, au petit jour, barrière Saint-Jacques, dans un lieu désert, devant personne. Il me semblait qu'elle commençait à se cacher, et je l’avais félicitée de cette pudeur. Eh bien ! messieurs, je me trompais, M. Léon Faucher se trompait. (On rit.) Elle est revenue de cette fausse honte. La guillotine sent qu’elle est une institution sociale, comme on parle aujourd’hui. Et qui sait ? peut-être même rêve-t-elle, elle aussi, sa restauration. (On rit.) La barrière Saint-Jacques, c’est la déchéance. Peut-être allons-nous la voir un de ces jours reparaître place de Grève, en plein midi, en pleine foule, avec son cortège de bourreaux, de gendarmes et de crieurs publics, sous les fenêtres mêmes de l’hôtel de ville, du haut desquelles on a eu un jour, le 24 février, l’insolence de la flétrir et de la mutiler ! » Maxime Du Camp donne le même sens au transfert à la place de la Roquette : Maxime Du Camp. Paris, ses organes, ses fonctions et sa vie jusqu’en 1870, réed. Monaco, G. Rondeau, 1993, p. 319-320 « Au mois de juin 1851, après l’exécution de Viou, la place de la barrière Saint-Jacques est délaissée, et le 16 décembre de la même année, Humblot fut décapité au rond-point de la Roquette, à la porte de la prison où il avait attendu qu’on prononçât sur son pourvoi en cassation et son recours en grâce. Depuis cette époque, les vingt et un condamnés à mort qui, à Paris, ont subi leur peine, ont été décapités sur cet étroit emplacement, à un endroit qu’on peut facilement reconnaître à cinq dalles encastrées au milieu du pavage destiné à supporter d’aplomb les chevalets de l’échafaud. La place semble avoir été choisie avec un discernement particulier. On donne à la loi ce qu’elle exige, mais rien de plus. Si l’exemple existe dans ces terribles solennités de la justice, il est en sens inverse de celui qu’on voudrait atteindre. Puisque l’article 26 du code pénal, qui dit : « L’exécution se fera sur une des places publiques du lieu qui sera indiqué par l’arrêt de condamnation » n’a pas encore été abrogé, il faut que le châtiment soit public ; mais le temps n’est plus où les grands seigneurs, faisant revêtir la livrée à leurs gens, les forçaient à assister, place de la Grève, au supplice des criminels et leur disaient que c’était là une bonne école de moralisation pour les domestiques. On sait de quels éléments gangrenés et pourris se compose la masse des curieux qui se pressent à ces douloureux spectacles ; on n’ignore pas les scandales sans nombre qui se produisent dans cette agglomération de mauvais monde ; plus qu’autrefois on a aujourd’hui souci d’une certaine réserve, et, tout en obéissant au principe encore trop absolu de la législation, on lui arrache, au profit de la morale, tout ce qu’on peut lui dérober. Les hauts bâtiments du dépôt des condamnés et ceux de la maison des jeunes détenus sont un obstacle invincible à la curiosité malsaine de la population ; les arbres sont nombreux, pressés, feuillus, qui empêchent de voir ; l’échafaud, dressé presque contre les murailles de la prison, est en retrait, pour ainsi dire, et dissimulé autant que possible ; au lieu d’aller chercher le public, comme autrefois, de le prendre à témoin de l’acte suprême que la société se croit forcée d’accomplir, on le relègue, on l’écarte, on se cache de lui… » Pour en savoir plus : Notice de l’encyclopédie libre Wikipédia sur la prison de la Roquette et celle sur la prison de la Santé. Voir la notice biographique d’Alexandre Dumas sur l’encyclopédie libre Wikipédia. Lire les textes complets de Victor Hugo sur le site Victor Hugo contre la peine de mort de Danielle Girard (académie de Rouen).
De la place de la Grève à la Roquette (suite)
Source : Extrait d’Alexandre Dumas, Mes Mémoires, chap. 222.Le réveil de Vacher (1899)
Source : Collection du Musée de l'Histoire vivante – Montreuil.
Le Petit Journal. Supplément illustré, 15 janvier 1899 (Collection Musée de l’Histoire vivante – Montreuil) Joseph Vacher (1869-1898), inculpé d’une douzaine de meurtres, est jugé et condamné par la cour d’assises de l’Ain le 28 octobre 1898 et exécuté le 31 décembre suivant. Il avait violenté, mutilé et tué de jeunes adolescents, bergers ou bergères pour la plupart. Ce tueur en série – le « tueur de bergers » - avait échappé à la justice pendant plusieurs années en se déplaçant après chacun de ses crimes commis dans presque toute la France, dans des régions très éloignées les unes des autres. La marche au supplice a été l'objet de nombreuses descriptions ou représentations. À l’égal des comptes-rendus stéréotypés de la presse provinciale (cf. la page d'une exécution à Chartres ci-après), les journaux illustrés veulent faire vivre à leur public les derniers instants du condamné à mort : le réveil, la concertation avec l'aumônier, la toilette, le parcours conduisant à la guillotine. Pour le condamné et le lecteur, le moment du réveil est un des plus dramatiques : l’heure exceptionnelle, la présence des représentants de l’autorité font prendre immédiatement conscience que la grâce a été rejetée et qu’il s’agit maintenant de se préparer pour aller au supplice. M. Claude, chef de la police de sûreté de Paris, fait une description économe de ces derniers instants, que l'on pourra comparer avec le récit du même sur l'exécution de Troppmann. Extrait des Mémoires de Monsieur Claude, chef de la police de sûreté sous le Second Empire, présentés par Sylvain Goudemare, Paris, Arléa, 1999, chap. XVIII. Les trois cellules de la Roquette, p. 175-178. "…Jamais les condamnés de la Roquette ne sont en contact avec un condamné à mort ; à l’heure de son exécution, sa route est réglée à l’avance ; elle est invariable pour tous. Les volets des cours sont hermétiquement clos, pour qu’on n’aperçoive ni le patient, ni son funèbre cortège. La consigne est donnée pour qu’aucun détenu ne sorte de sa cellule. Ce matin-là, la Roquette est en deuil. C’est vers le bâtiment de l’infirmerie, dont les murs touchent la rue Vacquerie, que commence, à partir des trois cellules, la route du condamné à mort pour se rendre à l’échafaud. Après avoir franchi le préau à arcades, le patient parvient à un escalier à vis, dont la spirale rappelle les marches tournantes et les assises architectoniques des édifices du Moyen Âge. Oh ! cet escalier en colimaçon ! Il semble avoir été construit pour rappeler les époques les plus terribles, les plus sombres et les plus barbares. Ses marches sont si hautes qu’elles doivent causer d’insupportables angoisses aux malheureux qui ne peuvent que fléchir dans l’épouvante qui les accable. Que de fois cette spirale de pierres noires a dû être cramponnée (176 ->) par les condamnés trébuchant, à bout de remords, affolés de terreur. Après cet escalier, le condamné franchit un couloir où sont les dortoirs ; il redescend pour entrer dans la salle dite du dépôt. C’est au dépôt que se fait sa toilette, sur un escabeau, toujours le même depuis trente ans. Ah ! si cet escabeau pouvait parler ! Dès que le condamné est sorti de sa cellule pour entrer dans cette chambre de toilette, il n’appartient plus au directeur de la prison, il appartient au bourreau, qui vient de faire dresser pour lui, au-dehors, et sa machine et son couperet. M. de Paris a en mains un ordre qui le rend maître absolu de sa capture. En vertu de cet ordre, l’exécuteur des hautes œuvres se présente au directeur, qui lui abandonne le patient. Lorsque le bourreau aborde le condamné, ayant à ses côtés son aumônier et ses deux gardiens, l’exécuteur l’appelle par son nom. Ordinairement, le condamné se tait. L’exécuteur lui met la main sur l’épaule et lui dit, comme s’il lui avait répondu : « Au nom de la loi, vous m’appartenez. » L’exécuteur signe un reçu, qu’il remet au directeur pendant que le condamné s’apprête à suivre l’exécuteur jusque sur la fatale machine, n’ayant plus qu’une étape à faire, avant d’aller à la mort, à sa chambre de toilette. C’est là que l’exécuteur prend, à l’égard du patient, ses dispositions et ses précautions. Un exécuteur de Paris a adopté un système fort simple, qui remplace, au moment du supplice, les ligaments de la camisole de force. Les mains du condamné sont liées dans le dos, ses pieds sont attachés l’un à l’autre par une courroie assez longue pour rendre la marche possible. Une troisième courroie va des mains aux pieds ; de cette façon, le patient marche parfaitement droit ; tout autre mouvement du corps se communique aux pieds et provoque forcément le trébuchement. En sortant de la chambre de toilette du dépôt, le condamné n’a plus que quelques pas à faire pour terminer sa funèbre excursion, qui n’a duré que trop longtemps." M. Claude inspire un rapport du service de sûreté parisienne adressé au ministère de l'Intérieur le 27 juin 1870 qui suggère de se concerter avec l'exécuteur sur les réformes à introduire en faveur des condamnés à mort dans les derniers instants de leur supplice, « afin d'abréger d'autant la durée de leurs souffrances morales », estimant que l'on peut faire passer le temps de préparation de 30 à 15 minutes. Parmi les mesures proposées, l'arrêté du préfet de police de Paris du 6 juillet 1870 retient la suppression de la camisole de force (qui demandait beaucoup de temps à être enlevée et remise) et la décision de faire couper les cheveux dès le moment de la condamnation à mort. Pour en savoir plus : Voir la notice biographique de Joseph Vacher sur l’encyclopédie libre Wikipédia, la bibliographie sur le site Criminocorpus et lire le dossier complet du procès de Vacher sur le site des Archives départementales de l'Ain.
Le dernier voyage de Castaing (1823)
Source : Archives de la préfecture de police, DB/142.
L’Expiation, gravure des Causes célèbres de tous les peuples, par Armand Fouquier, Paris, Lebrun, vol. 6, n° 248, p. 16. (Archives de la préfecture de police, DB/142) Edme-Samuel Castaing (1797-1823), médecin, est condamné par la cour d’assises de la Seine le 17 novembre 1823, pour avoir empoisonné les frères Hippolyte et Auguste Ballet. Il est exécuté le 6 décembre 1823. Les victimes et l’accusé appartenant à la bonne société parisienne, comme le mode opératoire (l’usage de substances vénéneuses) donnent une grande audience au procès. Tant que l'exécution se déroule place de la Grève ou aux barrières Saint-Jacques, le condamné quitte sa prison (la Conciergerie ou Bicêtre) pour un long parcours à travers la ville, comme cela se faisait dans les siècles passés dans un souci d'édification : l'exposition au public veut montrer que le criminel va être retranché du corps social par le châtiment suprême. Le remplacement de la charrette par « le panier à salade » et surtout l’exécution près de la prison à partir du milieu du XIXe siècle supprime ce parcours humiliant pour le condamné. Alexandre Dumas évoque ainsi le parcours et l'exécution de Castaing dans ses Mémoires, chap. XCI. "Non, je n'assistai point à l'exécution ; car, je l'avoue, ce me serait chose impossible à supporter qu'un pareil spectacle ; et, pourtant, de Castaing à Lafourcade, les vingt-huit années écoulées ont été fécondes, malgré cette peine de mort, qui devrait réprimer et qui ne réprime pas ! Hélas ! pendant ces vingt-huit années, combien de grands coupables ont passé sur la route qui conduisait alors de la Conciergerie à la place de Grève, et qui conduit aujourd'hui de la Roquette à la barrière Saint-Jacques ! Le 6 décembre, à sept heures et demie du matin, Castaing fut amené de Bicêtre à la Conciergerie. Un instant après, le greffier entra dans sa prison et lui annonça le rejet de son pourvoi. Derrière le greffier parut l'abbé Montès. Alors, Castaing se mit à prier, et pria longuement et religieusement. Pendant tout le temps qu'il passa dans le vestibule de la Conciergerie, et qu'on le prépara au supplice, il ne prononça pas un seul mot. En montant dans la charrette, en jetant un regard sur cette foule immense qui l'attendait, ses joues, devenues pourpres subitement, passèrent peu à peu à une pâleur mortelle. Au pied de l'échafaud seulement, il releva sa tête, qui, durant tout le trajet, était restée penchée sur sa poitrine ; puis, après avoir encore promené son regard sur la foule, comme il avait fait en sortant de la Conciergerie, il se mit à genoux au pied de l'échelle, et, lorsqu'il eut embrassé le crucifix d'abord, ensuite le digne ecclésiastique qui le lui présentait, il monta sur l'échafaud, soutenu par les deux aides de l'exécuteur. Tandis qu'on le liait sur la planche fatale, deux fois, bien visiblement, ses yeux se levèrent au ciel ; puis, à deux heures un quart, le quart sonnant, sa tête tomba. Castaing venait d'éprouver cette sensation mortelle qu'il n'avait osé définir à l'audience, quand il avait porté sa main à son cou. Castaing – aux pieds de Dieu –, coupable, recevait son pardon ; innocent, se faisait accusateur. Il avait demandé à voir son père pour recevoir sa bénédiction in extremis ; cette grâce lui fut refusée. Il réclama, alors, cette bénédiction par écrit. Elle lui fut envoyée ainsi, mais ne lui arriva que passée au vinaigre. On craignait que la bénédiction paternelle ne cachât quelque poison, à l'aide duquel Castaing trouvât moyen de ne pas payer sa dette à l'échafaud. Tout était fini à deux heures et demie, et ceux qui voulurent avoir la comédie après le drame eurent encore le temps d'aller, de la place de Grève, prendre leur poste à la queue du Théâtre-Français. – Le même jour, 6 décembre 1823, on jouait L'Ecole des vieillards." Pour en savoir plus : consulter la bibliographie sur le site Criminocorpus et lire le texte complet d’Alexandre Dumas sur le site Alexandre Dumas et deux siècles de littérature vivante.
L’exécution de Berland et Doré (27 juillet 1891) : la sortie de la Roquette
Source : Collection du Musée d’histoire vivante – Montreuil.Le Petit Journal. Supplément illustré, 8 août 1891 (Collection Musée de l’Histoire vivante – Montreuil) Depuis le milieu du 19e siècle, l'exécution à Paris se fait place de la Roquette, jouxtant le dépôt des condamnés de la Grande Roquette. Dès l’ouverture de la porte de la prison le condamné, suivi des autorités en charge du bon déroulement de l’exécution, soutenu par les aides de l’exécuteur et l’aumônier de la prison, découvre l’instrument du supplice dressé à quelques mètres.
L’exécution de Berland et Doré (27 juillet 1891) : le procès-verbal de police
Source : Archives de la préfecture de police de Paris, BA/887.Procès-verbal d’exécution capitale des nommés Doré et Berland, 27 juillet 1891 (Archives de la préfecture de police de Paris, BA/887) Gustave-Georges Doré (1872-1891), garçon boucher à Courbevoie et Adolphe-Eugène Berland (1871-1891), matelassier à Asnières, ont été condamnés à mort par la cour d’assises de la Seine le 13 juin 1891 pour l’assassinat d’une vieille femme à Courbevoie. Le procès-verbal d’exécution a un contenu très formalisé, comportant toujours les mêmes informations dans un ordre respecté à l’identique pour chaque cas. Il débute par la mention de la date et de l’heure, puis après le rappel de la réquisition du parquet et de l’arrêt d’assises, annonce le transport du policier au greffe de la prison où le rédacteur prend note sur le registre d’écrou de l’identité du ou des condamnés. Il décrit ensuite le transport à la cellule du condamné, l’annonce à ce dernier de son exécution, cette dernière étant décrite avec économie, sauf s’il y a des incidents. Les vœux et dernières paroles du condamné sont relevés. L’exécution terminée, on constate le transport du corps au cimetière de Gentilly.
L’exécution de Berland et Doré (27 juillet 1891) : le procès-verbal de police (suite)
Source : Archives de la préfecture de police de Paris, BA/887.L’exécution de Berland et Doré (27 juillet 1891) : le procès-verbal de police (fin)
Source : Archives de la préfecture de police de Paris, BA/887.L’exécution de Berland et Doré (27 juillet 1891) : articles de presse
Source : Archives de la préfecture de police de Paris, BA/887.Extraits des journaux Le Monde, 25 juillet 1891 et Le Rappel, 26 juillet 1891 (1891 (Archives de la préfecture de police de Paris, BA/887) Généralement, les récits d’exécution sont économes de mots et se rapprochent du procès-verbal de police, surtout après le milieu du XIXe siècle, quand autorités et élites répugnent de plus en plus à mettre en avant le spectacle de la guillotine. Les journalistes de la « grande presse » s’arrêtent davantage sur deux aspects : d’une part, la quête d’informations sur l’attitude du condamné pendant son séjour à la Grande Roquette, dans l’attente de l’issue de son recours en grâce, et, d’autre part, la vigilance quant à l’imminence du moment de l’exécution. Au premier chef, il s’agit de publier les paroles supposées, les écrits et lettres des condamnés, en jouant sur le contraste du « monstre » qui a tué et de l’être humain qui a une famille et cherche à échapper à la mort. Au second, bien moins que le déroulement technique de l’exécution, on décrit longuement la foule en attente du spectacle qui va être donné. C’est cet aspect qui est présent dans les deux articles cités. Tout en alimentant l’avidité des spectateurs en supputant à l’avance la date de l’exécution, en publiant des articles sur le crime et le condamné, la presse se donne le beau rôle en critiquant la foule venue au spectacle. Pour la presse hostile à la peine capitale, comme Le Rappel, cette « fête de nuit » est un argument de plus en faveur de l’abolition.
L’exécution de Berland et Doré (27 juillet 1891) : le spectacle
Source : Archives de la préfecture de police de Paris, BA/887.Rapport de police, signé Félix, 22 juillet 1891 ((Archives de la préfecture de police de Paris, BA/887) Habituée aux foules, parfois nombreuses, venant assister aux exécutions et craignant d’éventuels débordements, la préfecture de police de Paris prend à l’avance ses précautions, et organise un dispositif de surveillance des abords de la place de la Roquette lorsque la rumeur commence à faire venir les curieux désireux de « réserver leur place ». Le rapport rend compte d’une rafle qui a été effectuée, à la grande satisfaction des commerçants du quartier, parmi les prostituées et souteneurs qui n’ont d’ailleurs que peu de chemin à faire pour venir, puisqu’ils résident dans les « bouges » des rues voisines. Dans tous les rapports de police comme dans les articles des observateurs hostiles à la publicité des exécutions capitales, on trouve cette allusion à la « tourbe » malfaisante des « filles » et de leurs souteneurs venant faire la fête tout en souhaitant dire un dernier adieu à l’un des leurs, en espérant que ce dernier fera bonne figure sur la « bascule à Charlot ».
L’exécution de Berland et Doré (27 juillet 1891) : le spectacle (suite)
Source : Archives de la préfecture de police de Paris, BA/887.L’exécution de La Pommerais (9 juin 1864) par Villiers de l’Isle Adam
Source : Le Figaro, 23 octobre 1883.
Récit de l’exécution de La Pommerais par Villiers de l’Isle Adam, Le Figaro, 23 octobre 1883. Auguste de Villiers de L’Isle-Adam (1838-1889), écrivain proche du symbolisme, avait la réputation de fréquenter les exécutions. Edmond Couty de La Pommerais (1830-1864), médecin parisien, est condamné le 16 mai 1864 par la cour d’assises de la Seine, pour avoir empoisonné à la digitaline sa maîtresse et sa belle-mère afin de s’approprier un héritage. La description des derniers instants du condamné, du réveil à l’exécution, correspond parfaitement à la réalité. Villiers de L'Isle-Adam mentionne la présence du docteur Velpeau qui aurait demandé à son confrère supplicié d'ouvrir les yeux quand il l'appellerait une fois sa tête coupée : la question du temps de survie après la chute du couperet préoccupe pendant longtemps les milieux médicaux. Pour en savoir plus : Voir la notice biographique de Villiers de L’Isle Adam sur l’encyclopédie libre Wikipédia, la bibliographie sur le site Criminocorpus et lire le texte sur le site Victor Hugo contre la peine de mort de Danielle Girard (académie de Rouen).
L’exécution de La Pommerais (9 juin 1864) par Villiers de l’Isle Adam (suite)
Source : Le Figaro, 23 octobre 1883.L’exécution de Troppmann (19 janvier 1870)
Source : Extrait des Mémoires de Monsieur Claude, Paris, Arléa, 1999, chap. XXXI, p. 311-313.
Extrait des Mémoires de Monsieur Claude, chef de la police de sûreté sous le Second Empire, présentés par Sylvain Goudemare, Paris, Arléa, 1999, chap. XXXI. La dernière heure de Troppmann, p. 311-313. Jean-Baptiste Troppmann (1849-1870) est condamné à mort par la cour d’assises de la Seine le 31 décembre 1869 pour l’assassinat de Mme Kinck et ses six enfants à Pantin. Le crime, le procès et l’exécution de Troppmann sont généralement considérés comme le premier exemple d’exploitation par la grande presse d’un fait-divers criminel : le Petit journal, créé en 1863, atteint alors des tirages considérables. On rapporte qu’un de ses journalistes aurait pris la place d’un aide du bourreau pour être au plus près de l’évènement ! L’Illustration évoque une « exécution triomphale ». Le récit de M. Claude, chef de la sûreté témoigne bien de cet aspect en insistant sur l’importante présence de la « populace », dans le contexte du déclin du régime impérial et du scandale de l’assassinat du journaliste républicain Victor Noir. Mais la « fête » est aussi du côté officiel puisque le directeur de la prison donne réception à cette occasion… Aux côtés du chef de la sûreté, M. Claude, qui remplit lors de cette exécution une de ses fonctions habituelles, se trouvait l'écrivain Ivan Tourguéniev qui nous a laissé de superbes pages sur cette exécution. En voici le texte intégral : L’exécution de Troppmann, in Isaac Pavlovsky, Souvenirs sur Tourguéniev, Paris, Albert Savine, 1887, 306 p. (voir également Ivan Tourguéniev. L’exécution de Troppmann, traduit du russe par Isaac Pavlovsky, Association des amis d’Ivan Tourguéniev, Pauline Viardot et Maria Malibran, 1979, 50 p ; et Ivan Tourguéniev. L’exécution de Troppmann et autres récits, Paris, Stock, 1999, p. 115-161). I Au mois de janvier de cette année, me trouvant à Paris, à table chez un de mes amis, je reçus de Maxime Du Camp l'invitation tout à fait inattendue d'assister à l'exécution de Troppmann. Il ne s'agissait pas seulement de son exécution; Du Camp me proposait de me faire mettre au rang des rares privilégiés autorisés à entrer dans la prison même. On n'a pas encore oublié le crime horrible commis par Troppmann ; mais, en ce temps-là, Paris s'intéressait autant, sinon plus, à lui et à son exécution prochaine qu'au nouveau ministère pseudo-parlementaire qu'à l'assassinat de Victor Noir tué de la main du prince Pierre Bonaparte si étonnamment acquitté depuis. Dans toutes les vitrines des photographes, on voyait des rangées entières de portraits qui représentaient un jeune gaillard, au large front, aux petits yeux noirs, à la bouche lippue. C'était l'illustre assassin de Pantin. Depuis plusieurs nuits de suite, des milliers de blousards se rassemblaient dans les environs de la Roquette, pour voir si on n'allait pas monter la guillotine, et se dispersaient seulement après minuit. Pris à l'improviste par l'invitation de Du Camp, je ne réfléchis pas longtemps et j'acceptai. Une fois ma parole donnée d'être au rendez-vous, près de la statue du prince Eugène, au boulevard du même nom, à 11 heures du soir, je ne voulus plus la reprendre. Une fausse pudeur m'empêcha de le faire. Si on allait penser que je manque de courage ! Pour me punir moi-même et donner un enseignement aux autres, je veux maintenant raconter tout ce que j'ai vu, revivre pour le souvenir toutes les pénibles impressions de cette nuit. Peut-être la curiosité du lecteur ne sera pas seule satisfaite; peut-être trouvera-t-il quelque utilité dans mon récit. II Devant la statue du prince Eugène, avec une poignée d'hommes. Du Camp nous attendait. Parmi eux, se trouvait également M. Claude, le célèbre chef de la police de sûreté, à qui Du Camp me présenta. Les autres étaient, comme moi, des visiteurs privilégiés, journalistes, chroniqueurs, etc. Du Camp me prévint que très probablement nous aurions à passer la nuit sans sommeil dans l'appartement du commandant directeur de la prison. L'exécution des condamnés a lieu, l'hiver, à 7 heures du matin ; mais il fallait être rendu avant minuit : autrement on ne pourrait plus fendre la foule. De la statue du prince Eugène jusqu'à la place de la Roquette, il n'y a pas plus d'un demi-kilomètre. Je n'ai encore rien vu d'extraordinaire. Il n'y avait, sur les boulevards, pas plus de monde que d'ordinaire. On eût peut-être pu remarquer que tous avançaient, quelques-uns même, surtout les femmes, par saccades, dans la même direction. En outre, tous les cafés, tous les mastroquets étincelaient de lumière, ce qui est rare dans ce quartier éloigné de Paris, surtout à une heure si tardive. La nuit n'était pas brouillardeuse, mais terne, humide sans pluie, froide sans frimas, une vraie nuit française de janvier. M. Claude déclara qu'il était temps d'aller, et nous nous mîmes en route. Il conservait son sans-gêne tranquille d'homme affairé, chez lequel des accidents pareils ne produisent plus d'autre sensation qu'un désir de se débarrasser au plus vite d'un devoir qui manque de gaieté. M. Claude est un homme d'une cinquantaine d'années, de taille moyenne, trapu, aux larges épaules, à la tête ronde, aux cheveux ras, aux traits petits, presque minuscules. Le front seul, le menton et la nuque, sont excessivement larges. Une énergie inébranlable se presse dans sa voix égale et sèche, dans ses petits yeux pâles et gris, dans ses doigts courts et forts, dans ses pieds musclés, dans tous ses mouvements lents mais fermes. Il est, dit-on, un maître dans son art, un malin qui inspire une grande terreur à tous les voleurs et assassins. Les criminels politiques ne sont pas de son ressort. Son collègue, M.J., que Du Camp me loua aussi beaucoup, a l'air d'un homme doux, presque sentimental, de manières plus fines. A part ces deux messieurs, et peut-être aussi Du Camp, nous étions tous – ou peut-être cela m'a-t-il paru ainsi - un peu gênés et comme confus, quoique nous suivions vaillamment la file, comme à la chasse. À mesure que nous nous approchions de la prison, il devenait plus populeux autour de nous, quoique de vraie foule il n'y en eût pas encore. On n'entendait ni cris ni conversations à haute voix. On voyait que la représentation ne commençait pas encore. Seuls, les gamins tourbillonnaient autour ; et, fourrant les mains dans les poches de leur pantalon et rabattant la visière de leur casquette sur leur nez, ils marchaient ça et là avec cette démarche traînante, cette démarche de canard qu'on ne voit qu'à Paris, et qui, en un clin d'œil, se transforme en une course agile et des bonds de singe. « Le voilà, le voilà ! c'est lui ! » dirent quelques voix autour de moi. «Savez-vous ? me dit Du Camp. On vous prend pour le bourreau. » Un bon début, pensai-je. M. de Paris, avec lequel je fis connaissance cette même nuit, est aussi chenu et de la même taille que moi. Tout à coup surgit un espace pas trop large, limité des deux côtés par des édifices semblables à des casernes, d'un aspect sale, d'une architecture vulgaire. C'est la place de la Roquette. À gauche, se trouve une prison, celle des jeunes détenus ; à droite, la maison de dépôt pour les condamnés, ou la prison de la Roquette. III Cette place était coupée en travers par des soldats placés sur quatre rangs. Quatre rangées pareilles s'alignaient à quatre cents pas derrière les premiers. Généralement, il n'y a pas de soldats ; mais cette fois le gouvernement, à cause du renom de Troppmann et de l'état des esprits échauffés par l'assassinat de Noir, croyait utile de ne pas se limiter à la police seule et employait des mesures extraordinaires. Les portes principales de la Roquette se trouvaient juste au milieu du vide laissé par les soldats. Quelques sergents de ville se promenaient lentement devant les portes. Un jeune officier, assez gros, avec un képi très richement galonné, se précipita sur notre groupe avec une insolence qui m'a aussitôt rappelé le temps passé dans ma patrie ; mais, ayant reconnu les siens, il se calma. Avec de grandes précautions, on entrouvre à peine les portes et on nous laissa passer dans un petit poste, près des portes. Après nous avoir bien regardés et questionnés, on nous conduisit à travers deux cours intérieures, l'une grande et l'autre petite, dans l'appartement du commandant. Ce commandant, un homme fort, haut, avec des moustaches et une barbiche grises, la figure typique d'un officier de ligne français, le nez aquilin, les yeux immobiles et rapaces, et le crâne tout petit, nous reçut avec bonhomie et amabilité. Mais, malgré sa propre volonté, à chacun de ses gestes et de ses mots, on ne pouvait point ne pas remarquer que c'était un gaillard solide, un serviteur aveuglément dévoué, qui ne s'arrêterait pas devant l'exécution d'un ordre de son maître, quel qu'il soit. D'ailleurs, il a déjà prouvé son zèle : la nuit du coup d'État du 2 Décembre, il occupa avec son bataillon l'imprimerie du Moniteur. Comme un vrai galant homme, il mit à notre disposition tout son appartement. Il se trouvait au second étage du corps principal et consistait en quatre pièces assez bien meublées. Dans deux de ces pièces, il y avait des cheminées avec du feu. Une petite levrette, avec une patte déhanchée et des yeux tristes, comme si elle se sentait également prisonnière, en faisant frétiller sa queue, boitait d'un tapis sur l'autre. Nous autres - je veux dire les visiteurs -, nous, étions huit. Quelques-uns m'étaient connus d'après leurs photographies (Sardou, Albert Wolf), mais je ne voulais causer avec personne. Nous étions assis sur des chaises. Du Camp était sorti avec M. Claude. Il va sans dire que Troppmann est devenu le sujet de notre conversation et comme le centre de toutes nos pensées. Le commandant nous informa que depuis 9 heures du soir il s'était rendormi et dormait d'un sommeil profond ; qu'à ce qu'il paraît, il se doutait du sort de son recours en grâce : que lui, commandant, il l'avait supplié de dire toute la vérité et que, comme avant, il affirmait avec obstination qu'il avait des complices qu'il ne voulait pas nommer ; que probablement à la dernière minute il défaillerait ; que d'ailleurs il mangeait avec appétit et ne lisait pas, etc. De l'autre côté, quelques-uns parmi nous discutaient s'il fallait ajouter foi aux affirmations du criminel qui s'était montré menteur incorrigible. On répétait les détails du crime, on se demandait quelles seraient les opinions des phrénologues sur Troppmann, on soulevait la question de la peine de mort... Mais tout cela était si mou, si plat, avec des phrases si communes que ceux mêmes qui parlaient n'avaient pas envie de continuer. Causer de tout autre chose, on ne se sentait pas à l'aise pour le faire. C'était impossible par le seul respect de la mort et de l'homme qui lui était dévolu. Nous tous étions possédés d'une inquiétude lente qui nous faisait languir. Personne ne s'ennuyait, mais cette sensation poignante était cent fois pire que l'ennui. Il paraissait d'avance que cette nuit n'aurait pas de fin. Je ne sentais qu'une chose, c'est que je n'avais pas le droit de me trouver là où j'étais, qu'aucune raison psychologique et philosophique ne justifiait ma présence. M. Claude rentra et nous raconta comment le célèbre Jud lui avait filé entre les doigts. Il ne perdait pas, disait-il, l'espoir de le rattraper, s'il vivait encore. Soudain retentit un bruit lourd de roues ; et quelques moments après, on vint nous dire que la guillotine était arrivée. Nous nous jetâmes tous dans la rue, comme réjouis. IV Tout près devant les portes était arrêtée une lourde voiture fermée, attelée de trois chevaux à l'enfilade. Une autre voiture à deux roues, basse, petite et qui avait l'aspect d'une caisse oblongue, attelée d'un cheval, était là aussi un peu à l'écart. Cette voiture était destinée, comme nous le sûmes ensuite, à recevoir le corps après le supplice et à le porter au cimetière. On voyait près de la voiture plusieurs ouvriers à blouses courtes. Un monsieur de grande taille en chapeau rond, en cravate blanche, en paletot d'été jeté sur ses épaules, donnait des ordres à demi-voix. C'était le bourreau. Toutes les autorités, le commandant, M. Claude, le commissaire de police du quartier et les autres, l'entourèrent et le saluèrent. «Ah ! Monsieur Indric ! Bonsoir, monsieur Indric !» les entendait-on s'exclamer. Son vrai nom était Heidenreich. Il était alsacien. Notre groupe s'approcha aussi de lui. Pour un moment, il était devenu notre centre. Dans la manière de le traiter, on distinguait une familiarité tendue, mais respectueuse, comme si on voulait lui dire : « Nous autres, nous ne vous dédaignons pas. Vous êtes toujours un personnage très important. » Quelques-uns de nous, peut-être pour le chic, lui serrèrent même la main. Ses mains sont belles, très blanches. Je me rappelai le Poltava de Pouchkine : Le bourreau joua de ses blanches mains. M. Indric était très simple, très doux, très poli, avec une certaine gravité patriarcale. On aurait dit qu'il sentait que, cette nuit, il était à nos yeux la première personne après Troppmann, et comme son Premier ministre. Les ouvriers ouvrirent la voiture et commencèrent à en tirer toutes les parties constitutives de la guillotine qu'on devait ériger, ici même, à quinze pas de la porte. Deux lanternes commençaient à se promener en avant et en arrière, éclairant par petits cercles lumineux les pierres carrées du pavage. Je regardai ma montre : il n'était que minuit. L'air était devenu encore plus obscur et plus froid. Il y avait déjà foule. Derrière la haie de soldats qui s'effrangeaient devant le carré réservé à l'échafaud commença à s'élever un brouhaha. Je m'avançai vers les soldats. Immobiles, ils étaient un peu serrés et avaient rompu la régularité primitive des rangs. Leur physionomie n'exprimait rien : l'ennui froid et la patience obéissante. Même les figures que je voyais derrière les shakos des soldats, derrière les tricornes et les sergents de ville, les figures des blousards et des ouvriers, exprimaient la même chose, seulement avec un mélange de sourire indéfinissable. En avant, du fond de la foule qui se mouvait lourdement et qui se portait en avant, jaillissaient des exclamations : « Ohé Troppmann !... Ohé Lambert !... Fallait pas qu'y aille ! » Des cris, des sifflements perçants. On entendait distinctement une querelle et des injures au sujet des places. Un lambeau de chanson cynique rampait en serpentant. Tout à coup retentissait un rire aigu qui était soulevé par d'autres, et se mourait dans un large éclat. La véritable affaire n'était pas encore commencée. On n'entendait ni les cris antidynastiques qui étaient attendus ni le grondement orageux de La Marseillaise. Je revins dans le voisinage de la guillotine, qui s'élevait lentement. Un monsieur, aux cheveux bouclés, brun, chapeau gris, probablement un avocat, se tenait près d'elle et haranguait en gesticulant de sa main droite, l'index séparé, de haut en bas, et en fléchissant même les genoux pour accompagner l'effort. Il avait assumé la tâche de prouver à deux ou trois messieurs de l'entourage, en paletots boutonnés jusqu'en haut, que Troppmann n'était pas un assassin, mais un maniaque. « Un maniaque, je vais vous le prouver. Suivez mon raisonnement, affirmait-il. Son mobile n'était pas l'assassinat, mais un orgueil que je nommerai volontiers démesuré... Suivez mon raisonnement. » Les messieurs en paletot suivaient son raisonnement, mais, à en juger par leur physionomie, il est douteux qu'il les ait convaincus. Un ouvrier, qui se tenait sur la plate-forme de la guillotine, le regardait même avec un mépris non dissimulé. Je revins dans l'appartement du commandant. V Plusieurs de nos camarades y étaient déjà réunis de nouveau. L'aimable commandant leur offrait un punch américain. On commençait à discuter derechef si Troppmann continuait toujours à dormir, ce qu'il devait sentir, et si le bruit de la foule arrivait jusqu'à lui malgré l'éloignement de sa cellule de la rue, etc. Le commandant nous fit voir une montagne de lettres adressées au nom de Troppmann. Lui, disait-il, ne voulait pas les lire. La plupart étaient des farces plates, des mystifications, mais il en avait aussi de sérieuses où on le conjurait de se repentir, d'avouer tout. Un pasteur méthodiste lui envoyait toute une dissertation théologique en vingt pages. Il y avait aussi des billets de femmes. Dans quelques-uns se trouvaient même des fleurs, des marguerites, des immortelles. Le commandant nous dit que Troppmann avait essayé de se faire donner du poison par le pharmacien de la prison et lui écrivit une lettre que l'autre, cela va sans dire, remit immédiatement à qui de droit. Il me parut que notre hôte respectable ne pouvait bien comprendre à quel propos nous prenions intérêt à une bête aussi méchante et aussi méprisable que Troppmann, et il était prêt à expliquer notre curiosité par une oisiveté d'hommes du monde, de pékins. Après avoir causé un instant, nous nous dispersâmes chacun de notre côté. Pendant toute cette nuit, nous errâmes comme des âmes en peine. On entrait dans les chambres. On s'asseyait côte à côte sur les chaises; on s'informait de Troppmann, on regardait sa montre, on bâillait, puis on descendait encore par l'escalier dans la cour. Une fois dans la rue, on revenait, on s'asseyait de nouveau. Quelques-uns se racontaient des anecdotes piquantes, échangeaient des propos futiles. On discutait un peu politique, théâtre, assassinat de Victor Noir. D'autres essayaient de blaguer, de faire des bons mots. Seulement, ça ne marchait pas, ça provoquait un rire désagréable qui n'avait pas d'écho, une adhésion factice. Je trouvai un tout petit canapé dans la première chambre, et je m'y arrangeai avec peine en tâchant de m'endormir. Certes, je ne m'endormis pas, je ne m'assoupis même pas un seul instant. Le brouhaha de la foule devenait toujours plus fort, plus épais et ininterrompu. Vers 3 heures du matin, d'après le dire de M. Claude, qui entrait, s'asseyait sur une chaise, s'endormait tout de suite et s'en allait encore, appelé par quelques-uns de ses subordonnés, il y avait déjà plus de vingt-cinq mille personnes. Ce brouhaha m'étonnait par sa ressemblance avec les mugissements lointains du flux et du reflux de la mer, le même crescendo wagnérien infini qui ne monte pas régulièrement, mais avec de grands chuchotements et des déversements gigantesques. Les notes aiguës des voix des femmes et des enfants jaillissaient comme des éclaboussures fines sur le bourdonnement colossal. La puissance brutale d'une force de la nature se montrait dans tout cela. Tantôt elle s'apaise pour un instant comme si elle était couchée et ramassée... et la voilà encore qui grandit, s'enfle et gronde comme toute prête à s'élancer et à tout déchirer, qui recule encore et peu à peu se calme, puis de nouveau grandit... et cela n'a pas de fin. Que veut dire ce bruit ? pensai-je. Impatience ? Joie ? Haine ?... Non, il ne sert d'écho à aucun sentiment individuel humain. Tout simplement le bruit et le brouhaha de la nature. VI Vers 3 heures, je sortis à la rue, peut-être pour la dixième fois. La guillotine était prête. Troubles, plutôt étranges que terribles, se dessinaient sur le ciel foncé ses deux poteaux distancés d'un mètre l'un de l'autre avec la ligne oblique d'un couteau qui les réunissait. J'avais l'idée que ces poteaux devaient être à une plus grande distance l'un de l'autre. Ce rapprochement donnait à la machine une sveltesse lugubre, la sveltesse d'un cou long, tendu comme celui d'un cygne. Un long panier en osier, comme une malle, d'un rouge foncé, provoquait en moi un sentiment de dégoût. Je savais que les bourreaux jetteraient dans ce panier le cadavre chaud, encore palpitant, et la tête coupée. Un peu auparavant était arrivée la garde municipale qui s'était rangée en large demi-cercle devant la façade de la prison. Les chevaux s'ébrouaient de temps en temps mâchonnaient leur mors et saluaient de le tête. Entre les pieds de devant de chacun d'eux, sur le pavé, blanchissaient de larges flaques d'écume. Les cavaliers sommeillaient, sombres sous leurs bonnets à poil, très enfoncés sur les yeux. Les lignes de soldats qui coupaient la petite place pour contenir la foule s'étaient reculées plus loin. Devant la prison, un carré de trois cents pas, seul, demeurait évacué. Je m'avançai vers un des cordons de troupe et je regardai longtemps le peuple qui se pressait derrière. Il criait comme une force de la nature, c'est-à-dire stupidement. Je me rappelle la figure d'un jeune blousard d'une vingtaine d'années. Il se tenait la tête penchée et souriant comme s'il pensait à quelque chose de très amusant et tout d'un coup il levait la tête, ouvrait sa bouche grande et criait longuement sans articuler un mot, puis sa tête se penchait de nouveau et il riait encore. Qu'est-ce qui se passait dans cet homme ? Pourquoi se condamnait-il à passer une nuit de tourments sans sommeil, à supporter une immobilité presque de huit heures ? Mon ouïe ne saisissait pas les propos individuels. Quelquefois seulement, à travers le brouhaha ininterrompu, perçait le glapissement aigu des crieurs qui vendaient une brochure sur Troppmann, sur sa vie, son exécution et ses dernières paroles. Ou bien, quelque part, au loin, surgissaient une dispute, un rire stupide, un piaulement de femme satisfaite... Cette fois j'entendis La Marseillaise, mais elle n'était chantée que par cinq ou six personnes, et encore avec des interruptions. Or La Marseillaise n'a toute sa signification que quand elle est chantée par des milliers de voix. « À bas Pierre Bonaparte ! hurla une voix forte. - Ouh ! Ah ! » tempêta-t-on tout autour. Les cris dans une partie de cette multitude avaient pris soudain le rythme mesuré d'une polka connue sur l'air des Lampions. On respirait l'atmosphère lourde des foules ; une vapeur acre montait... Tous ces corps étaient imbibés de beaucoup de vin : il y avait là nombre d'ivrognes. Ce n'est pas en vain que les mastroquets brûlaient en points rouges sur tout le fond du tableau. La nuit, de sombre qu'elle était, devint noire ; le ciel rembruni devenait tout à fait noir. Sur les arbres clairsemés qui se dressaient comme des fantômes, l'on voyait de petites masses. C'étaient des gamins qui les avaient escaladés. Ils sifflaient et piaillaient comme des oiseaux perchés entre les rameaux. Un d'eux dégringola à terre et se tua en se cassant la colonne vertébrale. Mais sa chute ne provoqua qu'un rire qui ne dura pas longtemps. En revenant à notre appartement et en passant près de la guillotine, je remarquai sur la plate-forme le bourreau entouré d'un petit groupe de curieux. Il faisait pour eux l'essayage. Il basculait la planche dressée sur une charnière sur laquelle on boucle le criminel et qui, en tombant, entre par son extrémité dans la lunette entre les deux montants. Il faisait tomber la hache qui descendait lourdement et sans entraves avec un ronron sourd et précipité. Je ne m'arrêtai pas pour voir cette répétition, c'est-à-dire je ne montai pas sur la plate-forme : le sentiment d'un grave péché inconnu et d'une honte secrète augmentait toujours en moi. Peut-être dois-je rapporter à ce sentiment que les chevaux attelés à ces fourgons, et qui mangeaient tranquillement de l'avoine dans des sacs devant la porte de la prison, m'aient paru les seuls êtres innocents parmi nous. Je m'enfonçai de nouveau sur mon petit canapé et je me mis derechef à écouter le bruit du reflux de la mer. VII À l’encontre de ce qu'on affirme ordinairement, la dernière heure se passa plus vite que les premières, surtout que la deuxième ou la troisième. Nous fûmes tout étonnés d'apprendre que 6 heures venaient de sonner et qu'une heure seulement nous séparait du moment de l'exécution. Nous devions entrer dans la cellule de Troppmann dans une demi-heure, juste à 6 heures et demie. La somnolence disparut instantanément de toutes les figures. Je ne sais pas ce qu'ont senti les autres, mais mon cœur se serra fortement. De nouvelles figures apparurent. L'aumônier, petit homme au visage maigre, glissa comme un éclair dans sa longue robe noire d'abbé sur laquelle tranchait le ruban rouge de la Légion d'honneur, couvert d'un chapeau bas aux larges ailes. Le commandant nous avait arrangé une collation. Dans le salon, sur la table ronde, apparurent de gros bols de chocolat... Je ne me suis même pas approché, quoique l'hôte hospitalier me conseillât de me réconforter, car l'air matinal peut faire mal. Prendre de la nourriture à ce moment me parut dégoûtant. Était-ce l'heure des festins, grand Dieu ! Je n'en ai pas le droit, me disais-je pour la centième fois, depuis le commencement de cette nuit. « Et lui, il dort toujours ?» demanda quelqu'un parmi nous, avalant par petits coups son chocolat. Tous parlaient de Troppmann sans le nommer d'autre lui, il ne pouvait pas y en avoir. « Il dort, répondit le commandant - Malgré ce bruit terrible ? » Et en fait, le bruit avait gravement augmenté et mugissait d'une voix rauque. Le chœur grondant n'allait plus crescendo, mais il hurlait victorieusement, joyeusement. « Sa cellule est derrière une triple enceinte de murailles », répondit le commandant. M. Claude regarda sa montre. « 6 h 20. » Je suis sûr que nous tressaillîmes tous intérieurement. Cependant, nous prîmes tranquillement nos chapeaux et nous suivîmes avec bruit notre guide. « Où dînez-vous ce soir? » demanda un chroniqueur à haute voix. Mais cela parut par trop forcé. VIII Nous sortîmes sur la grande cour de la prison et là, dans un coin à gauche, devant la porte entrouverte, on fit quelque chose comme un appel nominal. Après cela, on nous introduisit dans une chambre étroite et totalement vide, avec un seul tabouret en cuir au milieu. « Ici, on fait la toilette du condamné », me chuchota Du Camp à l'oreille. Nous ne pûmes pas y entrer tous. Outre le commandant, l'aumônier, M. Claude et son aide, nous étions dix personnes. Pendant les deux ou trois minutes que nous passâmes dans cette chambre – une formalité d'écriture quelconque se fit pendant ce temps - l'idée que nous n'avions aucun droit de faire ce que nous faisions qu'en assistant avec une gravité feinte à l'assassinat d'un être semblable à nous, nous jouions une comédie illégale et abominable, cette idée passa dans ma tête pour la dernière fois. Aussitôt que nous nous mîmes en route de nouveau à la suite de M. Claude, dans un corridor large, pavé de pierres et faiblement éclairé par deux veilleuses, je ne sentis plus rien, sinon que ce serait bientôt, dans une minute, dans une seconde. Nous montâmes précipitamment, par deux escaliers, dans un autre corridor que nous parcourûmes également ; puis nous descendîmes un étroit escalier tournant et nous nous trouvâmes en face d'une porte en fer. « C'est ici. » Le gardien ouvrit avec précaution, la porte tourna sans bruit sur ses gonds et tous nous entrâmes doucement et sans parler dans une chambre assez vaste, aux murs jaunes et à la grande fenêtre grillée, avec un lit défait sur lequel personne n'était couché. La lumière égale d'un grand quinquet éclairait assez nettement tous les objets. Je me tenais un peu derrière les autres et je me rappelle que je clignotais. Tout de même, je vis tout de suite un peu en biais, vis-à-vis de moi, une figure aux cheveux et aux yeux noirs se mouvoir lentement de gauche à droite. Elle nous enveloppait tous d'un grand regard rond. C'était Troppmann. Il s'était réveillé avant notre arrivée. Il se tenait devant la table sur laquelle il venait d'écrire à sa mère une lettre d'adieu d'ailleurs assez banale. M. Claude leva son chapeau et s'approcha de lui. « Troppmann, dit-il de sa voix sèche, ni haute ni basse, mais sans réplique, nous sommes venus vous informer que votre recours en grâce est rejeté, et que l'heure de la réparation est arrivée pour vous. » Troppmann leva vers lui ses yeux, mais le grand regard de tout à l'heure n'y était plus. Il regardait tranquille, presque somnolent, et ne dit pas un mot. « Mon enfant ! » s'écria l'abbé d'une voix sourde. Et il s'approcha de lui de l'autre côté : « Du courage ! » Troppmann le regarda de la même manière que M. Claude. « Je savais qu'il ne serait pas lâche, dit M. Claude d'un ton de conviction, en se tournant vers nous. Maintenant qu'il a reçu le premier choc, j'en réponds.» Ainsi un professeur, voulant encourager son élève, l'appelle d'avance brave garçon. « Oh! Je n'ai pas peur! dit Troppmann, se tournant encore vers M. Claude. Je n'ai pas peur. » Sa voix, baryton agréable d'adolescent, était tout à fait égale. L'abbé prit dans sa poche une petite fiole. « Voulez-vous un peu de vin, mon enfant ? - Non, merci», répondit Troppmann avec un demi-salut courtois. M. Claude s'adressa encore à lui. « Vous continuez d'affirmer que vous n'êtes pas coupable du crime pour lequel vous êtes condamné. - Je n'ai pas frappé. - Cependant..., essaya d'intervenir le commandant. - Je n'ai pas frappé. » Les derniers temps, Troppmann commençait, à l'encontre de ses dires antérieurs, à affirmer qu'à vrai dire il avait amené la famille Kinck sur les lieux de l'assassinat, mais que ç'avaient été ses complices qui l'avaient tuée, et que même sa blessure à la main était due à ce qu'il eut l'idée de défendre un des petits enfants. D'ailleurs, pendant le procès, il mentit comme le firent des criminels avant lui. « Et vous continuez d'affirmer que vous avez des complices? - Oui. - Vous ne pouvez pas les nommer? - Je ne peux pas... je ne veux pas... je ne veux pas...» La voix de Troppmann s'élevait et sa figure s'illumina une seconde. Il parut qu'il allait se fâcher. « Bien, bien », répondit en hâte M. Claude comme s'il voulait montrer qu'il ne le questionnait que pour accomplir une formalité inévitable, et que maintenant il allait passer à autre chose. Troppmann devait se déshabiller. Deux gardiens s'approchèrent de lui et commencèrent à lui enlever sa camisole de force, sorte de blouse de toile bleue grossière, avec des courroies et des boucles, avec de longues manches en sac, du bout desquelles descendaient des ficelles fortes serrées autour de reins et vers la taille. Troppmann se tenait tourné de côté à deux pas de moi. On aurait pu dire que sa figure était belle s'il n'avait eu une bouche proéminente en haut et en bas comme une bête, et désagréablement enflée, au fond de laquelle on voyait de mauvaises dents clairsemées disposées en éventail. Des cheveux épais, sombres, un peu brûlés, des sourcils longs, des yeux expressifs à fleur de tête, un front ouvert et blanc, un nez droit avec une petite bosse et de petites bandes de duvet noir sur le menton... Si vous rencontriez une figure semblable ailleurs qu'en prison, sans tous ces accessoires, elle produirait à coup sûr sur vous une bonne impression. De ces têtes-là, on en rencontre par centaines parmi les jeunes ouvriers, les élèves des écoles publiques, etc. La taille de Troppmann était moyenne ; il était d'une maigreur d'adolescent très svelte. Il me parut un éphèbe ; d'ailleurs, il n'avait pas plus de vingt ans. La couleur de sa peau était tout à fait naturelle, saine, un peu rosée. Il ne pâlit pas même à notre entrée. Il n'y avait pas à douter qu'il avait vraiment dormi toute la nuit. Il ne levait pas les yeux et sa respiration était profonde et régulière, comme celle d'un homme qui monte avec précaution sur une grande montagne. Deux fois il secoua ses cheveux comme s'il voulait chasser une idée désagréable. Il releva la tête, jeta ses yeux vers le plafond et poussa un soupir à peine perceptible. À part ce mouvement presque instantané, on ne voyait en lui aucun signe, non seulement de peur, mais même d'émotion ou d'inquiétude. Nous autres, nous étions, sans aucun doute, plus pâles et plus émus que lui. Quand on lui délivra les mains des manches à sac de la camisole, il soutint sur la poitrine cette même camisole avec un sourire de contentement tandis qu'on le déliait par-derrière. Les petits enfants font ainsi quand on les déshabille. Puis il enleva sa chemise, en passa une autre propre qu'il boutonna avec soin. Il était étonnant de voir les mouvements larges et libres de ce corps nu, de ces membres nus sur le fond jaune des murs de la prison. Ensuite il s'inclina, mit ses bottines en tapant fortement des talons et des semelles sur le plancher et contre le mur, pour que ses pieds entrassent mieux et plus commodément. Il faisait tout cela d'un air délié, vite, presque gaiement, comme si l'on était venu l'inviter à la promenade. Il se taisait, nous nous taisions aussi et il nous regardait, haussant involontairement les épaules d'étonnement. Nous étions surpris de la simplicité de ses mouvements, une simplicité qui, comme tous les actes naturels de la vie, était de l'élégance. Un de nos camarades, que je rencontrai par hasard dans le courant de la journée qui suivit, me dit que pendant notre séjour dans la cellule de Troppmann, il pensait tout le temps que « nous n'étions pas en 1870, mais en 1794 », que « nous n'étions pas de simples citoyens mais des jacobins qui menaient à l'exécution non pas un assassin vulgaire, mais un marquis légitimiste, un ci-devant, un talon rouge, monsieur ». On sait que les condamnés à mort, après qu'on leur a lu le jugement, ou bien tombent dans une immobilité absolue, comme s'ils mouraient ou se décomposaient avant l'heure, ou bien font les bravaches, ou bien sont plongés dans le désespoir, pleurent, tremblent, demandent grâce. Troppmann n'appartenait à aucune de ces trois catégories : il étonnait M. Claude lui-même. Je remarquerai ici que, si Troppmann avait commencé à crier et à pleurer, mes nerfs n'auraient pu le supporter et je me serais enfui. Mais devant cette tranquillité, devant cette simplicité, je dirais même cette modestie, tous mes sentiments de dégoût envers l'assassin sans pitié, envers ce monstre qui coupait la gorge aux enfants pendant qu'ils criaient « maman ! maman ! », enfin la pitié pour un homme que la mort s'apprêtait déjà à engloutir se sont confondus en un seul : l'étonnement. Qu'est-ce qui soutenait Troppmann ? Serait-ce, quoiqu'il ne posât pas, qu'il figurait devant les spectateurs, qu'il nous donnait sa dernière représentation ? Serait-ce la bravoure innée, l'amour propre éveillé par les paroles de M. Claude, la pensée de la lutte qu'il fallait mener jusqu'au bout ou un autre sentiment encore inconnu ? C'est un mystère qu'il emporta avec lui dans la tombe. Il en est qui pensent encore que Troppmann ne jouissait pas de la plénitude de ses facultés. Je rappelais plus haut un avocat en chapeau gris que, d'ailleurs, je n'ai plus revu. L'inutilité, la bêtise de massacrer toute la famille Kinck peut, en quelque sorte, servir de base à cette conviction. IX Mais le voilà qui en a fini avec ses bottines. Il s'est redressé ; il s'est incliné comme pour dire : je suis prêt. On lui met de nouveau la camisole de force. M. Claude nous demande à tous de sortir et de laisser Troppmann seul avec l'abbé. Nous n'attendîmes pas plus de deux minutes dans le corridor. Sa petite silhouette, la tête droite et bravement rejetée en arrière, revint encore parmi nous. Le sentiment religieux était en lui faible, et probablement il accomplit en pures formalités les derniers actes de repentir devant l'abbé qui lui remettait ses péchés. Tout notre groupe, Troppmann au milieu, monta immédiatement l'escalier étroit en spirale que nous avions descendu un quart d'heure avant, plongé dans une complète obscurité. Le quinquet s'était éteint. Ce fut une minute terrible. Nous nous pressions tous d'atteindre le haut. On entendait le claquement précipité et brutal de nos pieds sur les dalles des marches. Nous nous poussions, nous nous heurtions de l'épaule. Un de nous perdit son chapeau. Quelqu'un derrière criait avec colère : « Mais, pour Dieu ! allumez donc la bougie, éclairez donc. » Et ici même, entre nous, dans une obscurité complète, notre compagnon, ce malheureux contre lequel nous nous pressions, comment était-il, lui ? Ne lui viendrait-il pas à la tête, en mettant à profit l'obscurité, de se jeter... où ? n'importe où, dans un coin éloigné de la prison, et là de se casser la tête contre le mur ? Au moins, il l'aurait fait lui-même. Je ne sais si cette pensée venait aux autres, mais elle était gratuite. Tout notre groupe, avec le petit homme au milieu, émergea des profondeurs de l'escalier dans le corridor. Évidemment, Troppmann appartenait à la guillotine, et la marche vers elle commença. X Cette marche ressemblait fort à une fuite. Troppmann marchait devant nous, à pas pressés, élastiques, presque sautillants. Il se hâtait, évidemment, et nous autres nous nous hâtions à sa suite. Quelques-uns le devançaient même, à droite et à gauche, pour le regarder encore une fois dans la figure. Ainsi, nous brûlâmes le corridor, nous descendîmes un autre escalier. Troppmann sautait quatre à quatre. Nous parcourûmes un autre corridor, nous sautâmes encore plusieurs marches et nous nous trouvâmes dans la chambre avec un seul tabouret, dont j'ai déjà parlé et où se fait la toilette du condamné. Nous entrâmes par une porte et, par la porte opposée, à pas graves, cravaté de blanc, habillé de noir, tout juste avec la mine d'un diplomate ou d'un pasteur, parut le bourreau. Derrière lui entra un petit vieillard, grassouillet, cravaté de noir, son premier aide, le bourreau de la ville de Beauvais. Le petit vieux tenait dans sa main un petit sac en cuir. Troppmann s'arrêta devant le tabouret. Tous se rangèrent autour de lui. Le bourreau et son aide, le petit vieux, se mirent à sa droite ; l'abbé, également à droite, un peu en avant. Le vieux ouvrit avec une clef la serrure du sac. Il prit quelques courroies de cuir cru avec des boucles, des longues et des courtes, et, s'étant agenouillé avec peine derrière Troppmann, il commença à lui lier les pieds. Troppmann, involontairement, mit son pied sur le bout d'une de ces courroies. Le petit vieux essaya de la dégager, dit par deux fois : « Pardon, monsieur. » Puis il toucha Troppmann au mollet. L'autre se retourna tout de suite avec son habituel demi-salut courtois, leva le pied et dégagea la courroie. L'abbé, pendant ce temps, lisait à mi-voix les prières en français dans un petit livre. Deux autres aides s'approchèrent, enlevèrent rapidement la camisole de Troppmann, lui placèrent les mains derrière le dos, les lièrent en croix et lui couvrirent tout le corps de courroies. Le bourreau chef donnait des ordres, indiquant de son doigt tantôt par-ci, tantôt par-là. Il arriva qu'il n'y avait pas la quantité nécessaire de trous sur les courroies pour les clous des boucles. Celui qui avait fait les trous comptait sans doute sur un homme fort. Le petit vieux commença à fouiller dans son sac, puis mit la main dans chacune de ses poches et, après y avoir bien tâté, il sortit finalement d'une d'elles une petite alêne recourbée à l'aide de laquelle il se mit à creuser la courroie avec effort. Ses doigts malhabiles, enflés par la goutte, lui obéissaient très mal. En outre, le cuir était épais et neuf. Il faisait un trou, essayait : il fallait creuser encore. L'abbé, probablement, devina que l'affaire ne marchait pas. Par deux fois il regarda par-dessus l'épaule, ralentissant les mots de la prière pour donner au vieux le temps de se tirer d'affaire. Enfin l'opération, pendant laquelle, je l'avoue franchement, une sueur froide m'avait envahi, était finie. Tous les clous étaient entrés où il fallait... Une autre formalité succéda au bouclage. On pria Troppmann de s'asseoir sur le tabouret devant lequel il se tenait. Le même vieillard goutteux allait procéder à la taille des cheveux. Il sortit de petits ciseaux et, tordant ses lèvres, coupa d'abord avec précaution le col de la chemise de Troppmann, de la même chemise qu'il avait passée tout à l'heure et de laquelle on eût pu couper le col à l'avance. La toile était toute plissée et ne cédait pas au tranchant peu aiguisé. Le bourreau chef jeta un coup d'œil sur la besogne et parut mécontent : la découpure n'était pas assez grande. Il indiqua de sa main : le petit vieux goutteux recommença son travail et découpa encore un assez grand morceau de toile. Le dessus du dos était mis à nu, les omoplates en vue. Troppmann fit un mouvement : il faisait froid dans la chambre. Alors le vieux passa aux cheveux. Il posa sa main gauche grassouillette sur la tête de Troppmann, qui la courba aussitôt avec obéissance, et de la droite il se mit en devoir de lui tailler les cheveux. Des mèches de cheveux châtains, épais, glissaient sur les épaules, tombaient sur le parquet. Une d'elles glissa jusqu'à ma bottine. Troppmann courbait toujours la tête avec obéissance; l'abbé ralentissait encore plus le récitatif de la prière. Je ne pouvais détacher mon regard de ces mains jadis souillées de sang innocent, et maintenant posées l'une sur l'autre sans défense ; je ne pouvais surtout abandonner des yeux ce cou fin d'adolescent. L'imagination, malgré moi, traçait sur lui un rayon transversal. Ici, pensai-je, dans quelques moments, en brisant les vertèbres, en tranchant les muscles et les nerfs, traversera la hache de deux cents kilos. Et le corps, semblait-il, ne s'attendait à rien de semblable, tant il était lisse, blanc et bien portant... Involontairement, je me posais cette question : A quoi pense en ce moment cette tête si doucement penchée ? Se tient-elle avec obstination et, comme on dit, en serrant les dents à la seule idée de ne pas faiblir ? Ou bien des souvenirs du passé y passent-ils en tourbillons extrêmement variés et peut-être insignifiants ? Voit-elle la grimace agonisante d'un membre quelconque de la famille Kinck, ou bien tâche-t-elle simplement de ne rien penser, cette tête, et ne fait-elle que se répéter à elle-même : Ce n'est rien..., moins que rien..., nous allons voir ? Elle le répétera jusqu'à ce que la mort croule sur elle, alors qu'il ne sera plus temps de se désoler... Et le petit vieux coupait, coupait toujours. Les cheveux grinçaient sous l'étreinte des ciseaux. Enfin, cette opération aussi fut finie. Troppmann se leva brusquement et secoua la tête. Généralement, à ce moment, ceux des condamnés qui peuvent encore parler adressent leurs dernières suppliques au directeur de la prison, rappellent les dettes laissées ou leur argent, remercient les gardiens, prient de remettre à leurs parents le dernier billet ou bien une mèche de cheveux avec leur suprême adieu. Mais Troppmann, évidemment, n'était pas un condamné ordinaire. Il dédaignait de pareilles tendresses et ne prononça pas un seul mot. Il attendait silencieusement. On lui jeta sur les épaules une veste courte. Le bourreau le prit par le coude. « Voyons, Troppmann, clama la voix de M. Claude dans ce silence de tombeau, maintenant, dans un moment, tout sera fini. Vous persistez à déclarer que vous avez des complices ? - Oui, monsieur, je persiste », répondit Troppmann, avec le même baryton agréable et ferme, et il s'inclina un peu en avant, comme s'il s'excusait courtoisement et regrettait de ne pouvoir répondre autrement. « Eh bien! allons ! » dit M. Claude. Et nous nous mîmes tous en route. Nous sortîmes sur la grande cour de la prison. XI II était 7 heures moins une minute, mais le ciel était à peine éclairci et la même vapeur sombre enveloppait tout et effaçait les contours des objets. Le mugissement de la foule nous parvint en flot incessant et terriblement houleux, à peine eûmes-nous franchi le seuil. Sur les pavés de la cour notre petit groupe, qui était déjà devenu moins compact, se dirigeait très rapidement vers les portes. Quelques-uns de nous étaient restés en arrière et moi aussi, quoique je marchasse avec les autres, je me tenais un peu à l'écart. Troppmann trottait à pas pressés et menus. Les liens l'empêchaient de marcher. Comme il me paraissait maintenant petit, presque un enfant ! Tout d'un coup, lentement, comme une gueule, s'ouvrirent les deux battants des portes accompagnés en même temps d'un grand rugissement de la foule réjouie, satisfaite. Soudain, le monstre de la guillotine nous regarda avec ses deux poteaux noirs et le couperet suspendu. J'eus un frisson qui me glaça jusqu'au cœur. Il me sembla que le froid envahissait la cour par les portes. Cependant, je regardai encore une fois Troppmann. Il se rejeta en arrière, la tête haute, en pliant les genoux, comme si quelqu'un lui donnait un coup dans la poitrine. « Il va s'évanouir », chuchota quelqu'un près de moi. Mais il se redressa tout de suite et d'un pas ferme alla de l'avant. Sur ses pas, ceux de nous qui voulaient voir comment sa tête tomberait se jetèrent dans la rue... Moi, je n'eus pas assez d'empire sur moi-même. Le cœur serré, je m'arrêtai devant la porte. J'ai vu le bourreau se dresser brusquement comme une tour noire, sur le côté gauche de la plate-forme. J'ai vu Troppmann se séparer du groupe resté en bas et commencer à gravir les marches. Il y en avait dix, dix marches entières ! Je l'ai vu s'arrêter et se tourner en arrière : je l'entendis dire : « Dites à M. Claude... » Puis, comme il apparaissait en haut, des hommes de la droite et de la gauche se précipitèrent sur lui, comme une araignée sur une mouche. Ensuite, je l'ai vu tomber en avant et j'ai vu ses semelles battre l'air. Mais alors je me détournai et j'attendis. La terre paraissait se dérober sous mes pieds... Il me sembla que j'attendis terriblement longtemps. J'eus le temps de remarquer qu'à l'apparition de Troppmann, le bruit de la foule se tut comme un monstre qui s'endort. Un silence sans respiration. Devant moi se tenait une sentinelle, un jeune garçon aux joues rosés. Je pus remarquer qu'il me regardait avec une surprise stupide, avec terreur. J'eus même le temps de penser que ce soldat pouvait être né, dans un petit village perdu, d'une bonne et paisible famille... Et ce qu'il voyait maintenant ! Enfin retentit un bruit léger de bois qui se heurtent. C'était la chute de la lunette supérieure avec la découpure transversale pour laisser passer le tranchant, lunette qui prend le cou du criminel et rend sa tête immobile; puis quelque chose gronda sourdement, roula et éructa comme si un grand animal eût craché. Je ne puis trouver une comparaison plus exacte. Tout se couvrit d'un brouillard. Quelqu'un me soutint par le bras; je regardai : c'était l'aide de M. Claude, M.J..., que, comme je l'ai su après, mon ami Maxime Du Camp avait chargé de m'observer. « Vous êtes très pâle, voulez-vous de l'eau ? » me dit-il en souriant. Je le remerciai et je retournai dans la cour qui m'apparut, à ce moment, comme un refuge contre la terreur qui sévissait hors des portes. XII Notre société se réunissait au poste, près de la porte, pour prendre congé du commandant et laisser à la foule le temps de se disperser. Je m'y rendis et j'appris qu'étant déjà sur la planche, Troppmann détourna soudain la tête, si bien qu'elle n'entra pas dans la lunette et que les bourreaux furent obligés de l'y traîner par les cheveux. À ce moment, il mordit l'un d'eux, le bourreau chef, au doigt. Aussitôt après l'exécution, pendant que le corps, jeté dans la charrette, s'en allait dare-dare, deux hommes, profitant du tumulte inévitable, auraient pu rompre le cordon des soldats, et, en rampant vers la guillotine, tremper leurs mouchoirs dans le sang qui filtrait à travers les fentes du plancher. Mais j’entendis ces conversations comme dans un rêve. Je me sentais très fatigué et je n’étais pas le seul. Tous paraissaient épuisés, quoique tous, apparemment, se sentissent mieux, comme si leurs épaules fussent débarrassées d’un grand poids. Mais personne de nous, absolument personne, n’avait l’air d’un homme qui a assisté à l’exécution d’un acte de justice sociale. Chacun tâchait de se détourner de cette idée et de rejeter la responsabilité de cet assassinat. Nous prîmes, Du Camp et moi, congé du commandant et nous rentrâmes chez nous. Un océan entier d’être humains, hommes, femmes et enfants, roulait devant nous ses flots disgracieux et malpropres. Presque tous se taisaient. Seuls, les blousards s’apostrophaient çà et là. « Où vas-tu ? - Et toi ? » Et les gamins saluaient de sifflets les cocottes qui passaient en voiture. Quelles figures mornes, hâves et somnolentes ! Quelle expression de fatigue, de déception, de dépit flasque, sans motif aucun ! D’ailleurs, je n’ai pas vu beaucoup d’hommes ivres. Peut-être avait-on eu déjà le temps de les ramasser, ou bien ils étaient dessoûlés d’eux-mêmes. La vie de tous les jours emportait encore ces gens-là. Pourquoi, pour quelle sensation étaient-ils sortis des rails de leur existence ? Il est terrible de penser à ce qui se cachait là-dessous. À deux cents pas à peu près de la prison nous trouvâmes un fiacre vide dans lequel nous montâmes. Pendant la route, nous discutâmes, Du Camp et moi, de ce que nous avions vu et à propos de quoi peu avant, dans La Revue des Deux Mondes, il avait écrit des paroles si éloquentes et si vives. Nous parlions de la barbarie inepte et superflue de toute cette procédure du Moyen Age, grâce à laquelle l’agonie d’un criminel dure trente minutes, de 6h28 à 7 heures… du dégoût de tous ces travestissements, de cette coupe de cheveux, des voyages par les escaliers et les corridors… De quel droit fait-on tout cela ? Comment soutenir cette routine révoltante ? La peine de mort elle-même pouvait-elle être justifiée? Nous avons vu quelle impression produit ce spectacle sur le peuple ; l'édification de ce spectacle n'existe pas du tout. A peine le millième de la foule, pas plus de cinquante à soixante personnes, a-t-il pu, dans le crépuscule de cette heure matinale, à une distance de plus de cinquante pas, voir quelque chose à travers les lignes de soldats et les croupes des chevaux. Et les autres ? Quelle utilité, si minime qu'elle soit, ont-ils pu tirer de cette nuit d'insomnie, d'ivresse, de fainéantise et de perversion ? Je me rappelai le jeune blousard qui criait niaisement et dont j'observai la figure pendant quelques minutes. Se remettra-t-il aujourd'hui au travail en homme qui hait plus qu'avant la fainéantise et le vice ? Moi-même, quel profit en ai-je tiré ? Un sentiment d'admiration involontaire pour l'assassin, le monstre moral qui a pu faire preuve de mépris pour la mort. Est-ce que le législateur peut désirer des impressions pareilles ? De quel but moral peut-on encore parler après tant de démentis donnés par l'expérience? Je ne veux pas disserter. Cela m’entraînerait trop loin. Qui donc ignore que la question de la peine de mort est une de ces questions à l'ordre du jour, irrémissibles, à la résolution desquelles travaille l'humanité contemporaine ? Je serais content et je me pardonnerais à moi-même une curiosité mal placée, si mon récit donnait quelques arguments aux défenseurs de l'abolition de la peine de mort, ou du moins à l'abolition de sa publicité. Pour en savoir plus : consulter la bibliographie sur le site Criminocorpus.
L’exécution de Troppmann (19 janvier 1870) (suite)
Source : Extrait des Mémoires de Monsieur Claude, Paris, Arléa, 1999, chap. XXXI, p. 311-313.L’exécution de Barré et Lebiez (1878) : « l’avidité du public »
Source : Archives de la préfecture de police de Paris, BA/887.Rapport du chef de la police municipale de Paris suite à l’exécution de Barré et Lebiez, 10 septembre 1878 (Archives de la préfecture de police de Paris, BA/887) Aimé Barré et Paul Lebiez sont condamnés à mort par la cour d’assises de la Seine le 31 juillet 1878. Le premier avait tué une femme, rue Poliveau à Paris pour la voler, et le second l’a aidé à dépecer le corps pour l’expédier ensuite, dans une malle, au Mans. Ils sont exécutés le 7 septembre. C’est donc quelques jours après que le chef de la police municipale fait un rapport sur les foules de plus en plus nombreuses assistant aux exécutions, sur l’avidité et le caractère malsain qui incite à être le plus près possible de la guillotine et sur les moyens de remédier à ce qu’il considère comme un scandale. Prenant en compte son expérience, il commence par noter l’ampleur grandissante des foules : 25 000 30 000 personnes en ce début septembre 1878, affluence qu’il n’a jamais jusqu’alors rencontrée. On vient près d’une semaine à l’avance, ne quittant la place de la Roquette qu’après minuit quand on est certain que les préparatifs ne commenceront pas le jour même. Le rapport fait une analyse très intéressante sur la composition des spectateurs : à la masse du peuple tenu à distance éloignée de la place par les barrages de soldats, qui certes est « grossier » et prêt aux « désordres » mais dont on a aisément raison, le policier est outré par les privilégiés, qui arguent de recommandations pour se trouver aux premières loges. Tels les journalistes et le « tout-Paris » des désoeuvrés et soupeurs, bref « tous les degrés de l’échelle sociale » sont aux aguets. Le chef de la police municipale ne peut que douter de l’effet « moralisateur » de la guillotine et proposer de faire l’exécution sans publicité, à l’intérieur de la prison.
L’exécution de Barré et Lebiez (1878) : « l’avidité du public » (suite)
Source : Archives de la préfecture de police de Paris, BA/887.L’exécution de Barré et Lebiez (1878) : « l’avidité du public » (suite)
Source : Archives de la préfecture de police de Paris, BA/887.L’exécution de Barré et Lebiez (1878) : « l’avidité du public » (fin)
Source : Archives de la préfecture de police de Paris, BA/887.Un proposition d’interdire toute publicité (1909)
Source : Archives de la préfecture de police de Paris, DB/141.Proposition de loi relative à la suppression de la publicité des exécutions capitales, 14 janvier 1909 (Archives de la préfecture de police de Paris, DB/141) De nombreuses propositions de loi ont été faites pour interdire la publicité des exécutions capitales, en particulier par les parlementaires partisans du maintien de la peine de mort, conscients de l’absence d’intimidation d’un tel spectacle. Ce faisant, ils ruinent un de leurs principaux arguments et les abolitionnistes ont beau jeu d’insister sur une guillotine dont on est si peu sûr de son efficacité pour lutter contre le crime, qu’on finit par vouloir la cacher comme si on en avait honte. Toutefois, aucune de ces propositions n’aboutira avant 1939. L’originalité de la proposition citée est de s’en prendre à la presse accusée de faire la publicité, non de la guillotine, mais des criminels à travers l’évocation des derniers jours des condamnés, et d’offrir leurs « têtes coupées » en pâture aux lecteurs jusqu’au fin fond des campagnes. Pour les auteurs de ce projet de loi, renfermer l’échafaud dans la cour de la prison n’est pas suffisant, il faut aussi interdire toute représentation figurée de la scène de l’exécution et des condamnés. Il faudra attendre 1951 pour que ce vœu soit en partie exaucé avec la loi du 11 février 1951 qui interdit la publication de toute information sur le condamné « tant que le procès-verbal de l'exécution n'a pas été affiché, ou le décret de grâce notifié au condamné ou mentionné à la minute de l'arrêt ».
L’exécution de Lacenaire et la manipulation de la presse
Source : Extrait des Mémoires de Canler, tome I, 4e éd., Paris, F. Roy, 1882, p. 369-373.
Extrait des Mémoires de Canler, ancien chef de la police de sûreté, tome I, 4e éd., Paris, F. Roy, 1882, p. 369-373. Les crimes et le procès de Lacenaire ont créé un profond trouble dans l’opinion bourgeoise, scandalisée par la révolte permanente de l’intéressé, par sa guerre envers la société jusqu’à l’exécution, puisque aussi bien un de ses derniers poèmes écrits à la Conciergerie est une déclaration d’amour à la guillotine… Lacenaire apparaît comme le monstre absolu, sapant par son attitude insolente les fondements de l’ordre social. Aussi les autorités ont-elles à cœur de trouver une faille dans le personnage, pour prouver à l’opinion – via la presse – que Lacenaire est finalement un homme comme les autres avec ses faiblesses et ses lâchetés. La scène de l’exécution devient un enjeu : on espère qu’il fera preuve de faiblesse, témoignant ainsi qu’il est un homme comme les autres, manifestant sa peur au pied de l’échafaud. Le compte rendu donné par La Gazette des tribunaux va dans ce sens. Pour le chef de la police de sûreté qui a assisté à l’exécution la version est différente.
L’exécution de Lacenaire et la manipulation de la presse (suite)
Source : Extrait des Mémoires de Canler, tome I, 4e éd., Paris, F. Roy, 1882, p. 369-373.Un compte rendu d’exécution par la presse de province (Chartres, 1874)
Source : Extrait du Journal de Chartres, 1er octobre 1874.Extrait du Journal de Chartres, 1er octobre 1874 Louis Sylvain Poirier (1843-1874) est condamné par la cour d’assises d’Eure-et-Loir le 27 août 1874 pour cinq assassinats suivis de vols. Il est exécuté sur la place Morard à Chartres un mois après, le 29 septembre. Le récit du journal est représentatif des comptes-rendus relatifs à une exécution dans la presse provinciale. On retrouve un cadre narratif identique, avec toujours les mêmes séquences : arrivée des bois de justice, annonce au condamné du rejet de sa grâce, travail de l’aumônier (confession, messe, communion), arrivée du bourreau et de ses aides pour la toilette, montage de la guillotine, départ et transport jusqu’à la place du supplice, récit rapide de l’exécution qui privilégie le côté professionnel du bourreau en faisant silence sur le sang versé. On présente le condamné sinon comme un modèle de courage, du moins résigné, légitimant la peine qui lui est infligée. Pour en savoir plus : M'Sili (Marine), "Une mise en scène de la violence légitime : les exécutions capitales dans la presse (1870-1939)", in Bertrand (Régis), Carol (Anne) (dir.). L'exécution capitale, une mort donnée en spectacle XVIe-XXe siècle, Aix-en-Provence, Publications de l'Université de Provence, 2003, p. 167-178.
Un incident lors d’un exécution à Privas (1850)
Source : Document conservé au Centre historique des Archives nationales, Paris, BB/30/536.
Rapport du procureur général de la cour d’appel de Nîmes, 21 mars 1850 (Document conservé au Centre historique des Archives nationales, Paris, BB/30/536) Dans cette exécution qui se déroule à Tournon en 1850, le mécanisme entraînant la chute du couperet s’est enrayé et l’opération a dû être suspendue dix minutes, le condamné ayant dû être retiré de sa position le temps de la réparation. Le rapport du procureur montre bien la hantise de ce genre d’incidents pour les autorités : en dehors du fait qu’on « prolonge l’agonie du malheureux patient », on craint surtout que l’assistance, jetée dans une « horrible anxiété » soit amenée à commettre des excès sur les exécuteurs. La crainte n’est pas vaine car il y eut de tels incidents graves pendant le premier XIXe siècle. La Gazette des tribunaux décrit le 20 septembre 1831, sous la plume encore pleine d’émotion de son correspondant, le scandale causé par une exécution pour le moins laborieuse à Albi. Gazette des tribunaux, Lundi 19 et mardi 20 septembre 1831 EXÉCUTION D’HÉBRARD À ALBY (Correspondance particulière.) Souffrances inouies du condamné. – Horribles détails. Condamné à la peine de mort le 16 avril dernier (Voir la Gazette des Tribunaux du 8 mai), Pierre Hébrard avait quelque lueur d’espérance ; il comptait sur la demande qu’il avait formée en commutation de peine. Cinq mois s’étaient écoulés, et il croyait qu’on ne l’aurait pas laissé vivre si long-temps pour le faire mourir. C’est dans une telle position, que le lundi 12 septembre, à dix heures du matin, il apprend qu’il doit être exécuté à quatre heures du soir. Sa résignation a été remarquable ; il a fait appeler un prêtre, lui a avoué son crime avec autorisation d’en instruire le public. À quatre heures précises, on le tira de son cachot pour le mettre sur la fatale charrette ; mais à peine y est-il, qu’on lui annonce que l’exécution est retardée de deux heures : le malheureux croyait peut-être qu’un ordre de sursis venait d’arriver, il n’en était rien. Depuis près de cinq ans il n’y avait pas eu d’exécution à mort dans ce département ; l’échafaud se trouvait dérangé. Un aide que l’exécuteur avait renvoyé, est accusé de l’avoir fait pour jouer un mauvais tour à son maître. Aussitôt le procureur du Roi ordonne à un charpentier de le réparer, l’ouvrier obéit, et il paraît qu’après cette réparation, l’exécuteur pourra trancher la tête d’Hébrard. Cet infortuné arrive à six heures, une population immense entourait l’échafaud ; la gendarmerie le sabre à la main, avait fait laisser un grand espace vide ; le condamné monte d’un pas assuré ; il est lié à la planche qui fait bascule ; le bourreau et deux aides sont sur l’échafaud ; on introduit la tête dans la lunette, le couteau tombe, mais en vacillant ; le condamné n’est pas atteint. Aussitôt se fait entendre le frémissement de la populace, le couteau est levé de nouveau ; mais il tombe pour la seconde fois, et n’atteint pas encore le condamné ; il pousse alors des cris horribles ; une grêle de pierres est lancée sur les exécuteurs ; ils essayent une troisième fois d’exécuter le mandement de justice, mais en vain, le couteau ne fait qu’une blessure légère, et les cris du patient renouvelés avec plus de force, portent l’effroi dans tous les cœurs. L’exécuteur et ses deux aides, consternés eux-mêmes, et atteints par une grêle d’énormes pierres, furent obligés de franchir l’échafaud et de chercher leur salut dans la fuite ; Hébrard demeura toujours la tête dans l’horrible lunette. Quelle horrible position ! Il n’était presque pas blessé. Cela dura trois minutes environ ; l’exécuteur en chef remonte seul et essaie de nouveau de lui trancher la tête ; il lève le couteau à deux reprises, mais le couteau descend en vacillant et n’atteint pas le condamné. Il faut observer que la dernière fois, c’est-à-dire la cinquième, que le couteau fut levé, il entraîna dans son ascension la moitié de la lunette. Les pierres tombaient toujours sur l’échafaud, l’exécuteur descend et fuit, la lunette se trouvant levée, Hébrard eût la tête dégagée, et c’est alors qu’il se releva comme sortant du tombeau ; quelques hommes du peuple crièrent bravo, tant on était stupéfait de voir debout un homme que l’instrument de mort avait épargné cinq fois, c’est alors qu’il demanda du secours. Un ouvrier s’approcha de l’échafaud, mais il n’osa y monter. Deux minutes après, le plus jeune des aides de l’exécuteur, bravant les pierres et le cri de la populace, remonte seul, et a un très court entretien avec Hébrard. Il paraît que ce dernier lui disait : détachez-moi, car il était toujours attaché à la bascule. L’aide lui dit : tournez la tête, et à l’instant il le saisit debout, et frappe de plusieurs coups avec une dague dont se servent les sabotiers. La tête d’Hébrard à demi coupée, se penche sur l’épaule gauche, et l’aide est obligé de fuir et de chercher refuge auprès de la gendarmerie. Il était 6 heures 10 minutes. Hébrard, qui peut-être respirait encore, demeura deux heures dans cette position exposé aux regards du peuple. Quelques personnes affirment que pendant une demi-heure, il fit quelques mouvemens ; la bouche de temps en temps s’ouvrait. Comme le cadavre ne put être retiré qu’à l’aide d’une forte escorte, la maison de l’exécuteur fut entourée par la populace et les vitres cassées à coups de pierres. On doit dire à la vérité de dire que l’exécuteur n’a pas de reproches à se faire ; il résulte d’un rapport des gens de l’art nommés par le procureur du Roi que l’échafaud avait été dérangé exprès, et les plus grands soupçons se portent sur un aide qui avait été renvoyé auparavant. Voici les termes textuels du rapport : « Je soussigné, Jean-Pierre Sulvi-Frezouls, entrepreneur des bâtimens et maître charpentier, habitant à Albi, déclare m’être transporté, par ordre de M. le procureur du Roi, chez l’exécuteur de la haute justice, pour procéder à la vérification de l’instrument de mort. J’ai reconnu que les languettes du tranchant avaient été retouchées, ce qui l’empêche de tomber dans son aplomb ; que les reinures de la lunette l’avaient été aussi, mais dans le sens contraire de ce qu’elles devaient être, de manière que ledit tranchant ne pouvait descendre à sa destination sans rencontrer (la lunette). Je pense que l’on ne peut attribuer ce fait qu’à quelque individu qui eut quelque expérience dans cet état, et qu’il l’a fait par méchanceté. » L’exécuteur en chef s’arracha les cheveux de désespoir en voyant qu’il avait manqué son coup, et ce, la première fois que le couteau descendit. On peut maintenant demander si l’aide avait le droit de changer le supplice ordonné. La tête d’un condamné doit être tranchée, d’après l’article 12 du Code pénal. Une loi de 91 définit le mode d’exécution. Il est fait mention dans cette loi de l’horrible supplice que subit M. Lally-Tolendal. Tout Paris, toute la France, furent indignés lorsqu’on apprit que cette célèbre victime avait reçu plusieurs coups sans avoir la tête tranchée. Cet événement n’a pas peu contribué à l’invention de la guillotine, renouvelée d’une machine hollandaise. Hébrard n’a pas été guillotiné ; il a été poignardé, debout, avec un outil de sabotier. Veuillez, dans l’intérêt de l’humanité, discuter cette question. Que serait-il arrivé, s’il y avait eu deux condamnés à exécuter ? Un homme, quel qu’il fût, aurait-il eu le droit de les traîner sur l’échafaud et de les poignarder l’un après l’autre ? On ne saurait dépeindre l’horreur d’un pareil spectacle ; on entendait le tumulte à une lieue de la ville. Jamais, non jamais rien d’aussi déchirant n’avait porté à consternation dans une cité. Que les partisans de la peine de mort viennent puiser des enseignemens dans la scène du 12 septembre ! Un horrible assassin avait ouvert tous les cœurs à la pitié, et si Roussille, qui avait été la victime de l’assassinat, n’eût été un homme tant aimé dans le pays, le peuple aurait arraché son meurtrier au glaive de la loi. Tel est le récit exact de ce qui s’est passé. Notre correspondant s’excuse du désordre qui a pu s’y introduire lorsqu’il avait l’âme encore révoltée par de pareilles atrocités. »
Un incident lors d’un exécution à Privas (1850) (suite)
Source : Document conservé au Centre historique des Archives nationales, Paris, BB/30/536.