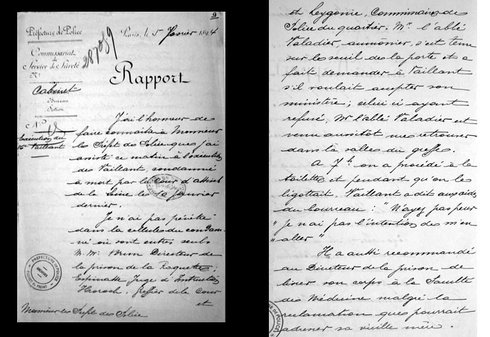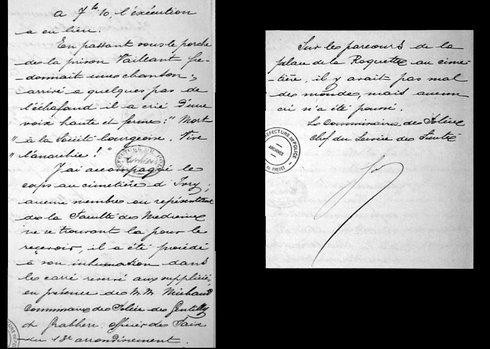... Du dimanche au lundi matin, dans la seule Roquette, on massacra dix-neuf cents personnes. Le sang coulait à force dans les ruisseaux de la prison. Mêmes égorgements à Mazas, à l’École militaire, au parc Monceau.
Plus sinistres, peut-être, les cours prévôtales où l’on feignait de juger. Elles n’avaient pas surgi au hasard, suivant les fureurs de la lutte. Bien avant l’entrée dans Paris, Versailles en avait fixé le nombre, le siège, les limites, la juridiction. Une des plus célèbres siégeait au Châtelet, présidée par le colonel de la garde nationale, Louis Vabre, celui des 31 Octobre et 18 Mars, puissante brute, à taille de cent-gardes. L’histoire possède les procès-verbaux des massacres de l’Abbaye, où les prisonniers, d’ailleurs très connus, purent se défendre. Les Parisiens de 1871 n’eurent pas la justice de Maillard ; à peine est-il trace de quatre ou cinq dialogues. Les milliers de captifs emmenés au Châtelet étaient d’abord parqués dans la salle, sous le fusil des soldats ; puis, poussés de couloir en couloir, ils débouchaient comme des moutons sur le foyer, où Vabre trônait entouré d’officiers de l’armée et de la garde nationale de l’ordre, le sabre entre les jambes, quelques-uns le cigare aux dents. L’interrogatoire durait un quart de minute. « Avez-vous pris les armes ? Avez-vous servi la Commune ? Montrez vos mains ? ». Si l’attitude était résolue ou la figure ingrate, sans demander le nom, la profession, sans marquer aucun registre, on était classé. « Vous ? » disaient-ils au voisin, et ainsi de suite, jusqu’au bout de la file. Ceux qu’un caprice épargnait étaient dits ordinaires et réservés pour Versailles. Personne n’était libéré.
On livrait tout chaud les classés aux exécuteurs, qui les emmenaient à la caserne Lobau. Là, les portes refermées, les gendarmes tiraient sans grouper leurs victimes. Quelques-unes, mal touchées, couraient le long des murs. Les gendarmes leur faisaient la chasse, les canardaient jusqu’à extinction de vie…
Au Luxembourg, les victimes de la cour prévôtale étaient d’abord jetées dans une cave en forme de long boyau, où l’air ne pénétrait que par une étroite ouverture. Les officiers siégeaient dans une salle du rez-de-chaussée garnie de brassardiers, d’agents de police, de bourgeois privilégiés en quête d’émotions fortes. Comme au Châtelet, interrogatoire nul et défense inutile. Après le défilé, les prisonniers retournaient dans une cave ou bien étaient conduits dans le jardin ; là, contre la terrasse de droite, on les fusillait. Le mur ruisselait de cervelles et les soldats piétinaient dans le sang.
Les assassinats prévôtaux se passaient de la même sorte à l’École polytechnique, à la caserne Dupleix, aux gares du Nord, de l’Est, au Jardin des Plantes, dans plusieurs casernes, concurremment avec des abattoirs sans phrases… »
Source : P.-O. Lissagaray, Histoire de la Commune de 1871, Paris, 1970, p. 374-375