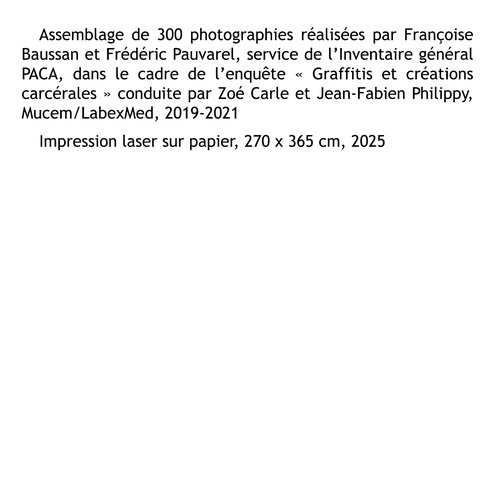L’entrée en détention commence par une fouille intégrale avant de se rendre à l’écrou (ou service du greffe). Le détenu dépose ses effets personnels et pièces d’identité qui sont enregistrés. Le personnel de l’administration pénitentiaire vérifie l’identité de la personne et contrôle la validité des mandats de dépôts, des mandats d’arrêts et de toutes les pièces relatives à l’incarcération. Il est également procédé à un relevé d’empreintes et à une photographie. Enfin, un numéro d’écrou est attribué à la personne détenue.
10. Le centre pénitentiaire des Baumettes, Marseille
Plan du chapitre
En 2019, le Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (Mucem) initie l'enquête "Graffitis et créations carcérales" dans le cadre du post-doctorat LabexMed-Mucem de Zoé Carle.
Le centre pénitentiaire de Marseille est une maison d'arrêt et un centre de semi-liberté dont la construction débute en 1932, d’après des plans de Gaston Castel (1886-1971), architecte en chef des Bouches-du-Rhône. Les bâtiments sont inaugurés par l'administration pénitentiaire en 1946.
L’enquête se déploie en deux volets : d’une part, la constitution d’une documentation photographique en partenariat avec le service de l’Inventaire général du Patrimoine culturel PACA confiée à Françoise Baussan et Frédéric Pauvarel qui prend pour objet la prison en tant que telle (ses bâtiments et son architecture, ses graffitis) et, d’autre part, une collecte d’éléments affichés dans les cellules, d’objets créés ou détournés par les détenus et relatifs à leur vie quotidienne.
Il ne reste aujourd’hui des anciennes Baumettes que le mur d’enceinte orné des sculptures d’Antoine Sartorio (1885-1988) représentant les sept péchés capitaux et la « prison hôpital des Baumettes » (P.H.B.). En 2021-2022, les "Baumettes historiques" sont entièrement détruites pour laisser place au nouveau centre pénitentiaire, Baumettes 3, inauguré en 2025.
L’enquête se matérialise par deux-mille-sept-cents photographies, cent-quarante documents collectés dans les cellules et les coursives versés aux archives du Mucem sous les cotes respectives 124P et 422W, ainsi que quarante-deux items inscrits à l’inventaire du musée provenant soit des cellules laissées à l’abandon, soit de saisies de l’administration pénitentiaire.
Fouille, greffe, vestiaire
Cellules
L’enquête-collecte s’est rapidement orientée sur la présence massive de graffitis dans l’espace de la prison. Ceux-ci se concentrent préférentiellement dans les cellules, espaces à la fois privatifs et collectifs dans un contexte de surpopulation carcérale. Le centre pénitentiaire des Baumettes a été conçu sur le modèle de Fresnes, un modèle cellulaire, mais dans les faits, les détenus étaient amenés à partager à trois ou quatre un espace restreint de 9m2.
Les murs des cellules servent de support d’expression et d’exposition : peintures murales, collages, affichages, graffitis… Parmi les pratiques d’exposition, il y a les documents détournés de leur usage initial : affiches, cartes, lettres, documents administratifs, magazines et pages de magazines… qui servent à la décoration de la cellule, à marquer l’identité et à recréer un univers familier en privation de liberté.
Les références au football et plus particulièrement au club marseillais sont omniprésentes et forment la spécificité de la prison des Baumettes historiques. Multiples et variées, elles se retrouvent du côté des détenus (cellules), du côté des surveillants (bureaux) et sont également « partagées » lorsqu’il s’agit des coursives. L’Olympique de Marseille constitue à la fois un dedans/dehors des expressions et l’une des identités de la ville relevant autant de l’imaginaire collectif que de la réalité.
Coursives
Les coursives sont également un lieu d’expression pour les personnes incarcérées. Parfois, leur intervention peut prendre un aspect inattendu comme avec cette peinture murale située au quartier arrivant et dédiée à l’Olympique de Marseille réalisée par un détenu sous la surveillance du personnel pénitentiaire.
Parloirs
Il existe plusieurs types de parloirs. Les parloirs classiques permettent à la personne détenue de rencontrer ses proches, seule, pendant une demi-heure ou une heure, plusieurs fois par semaine. Les parloirs familiaux permettent des rencontres d’une durée plus longue pouvant aller jusqu’à six heures dans une pièce plus grande et aménagée. Les unités de vie familiales (UVF) permettent quant à elles des rencontres une fois par trimestre, sous certaines conditions, pendant 72 heures maximum dans un petit appartement meublé de deux ou trois pièces. Les parloirs sont l’occasion d’une expression plus intime et familiale avec des graffitis réalisés autant par les personnes incarcérées que par des parents : une mère, un père, une sœur, un frère, la femme ou la petite amie d’un détenu.
Mur de ronde de la P.H.B.
En 1948, la « prison hôpital des Baumettes » (P.H.B.) est ouverte. Elle comprend trois bâtiments : un quartier pour hommes de 52 cellules, un quartier pour femmes de 32 cellules et un bâtiment central disposant notamment d’un bloc opératoire. Il est difficile de dater les graffitis, celui-ci pourrait remonter à la Seconde Guerre mondiale (1939-1945), à la Libération ou à la reconstruction (1945-1958), on y distingue un V et une croix de Lorraine, symboles de résistance, de lutte et d’espoir.
Carte imaginaire
En 2025, une carte imaginaire de la prison des Baumettes est réalisée à l’occasion de l’archivage de la campagne photographique au Mucem. L’objet s’inspire autant des travaux photographiques de David Hockney commencés au début des années 1980 et de Mathieu Pernot, DORICA CASTRA (2017) que des architectures de Paris du film Inception (2010) de Christopher Nolan dans la manière dont elles s’emboîtent, se plient et se déplient. Le travail de carte imaginaire sur les Baumettes associe des images de Françoise Baussan et Frédéric Pauvarel sur le plan masse de l’ancienne prison : bâtiments et murs d’enceinte. Le placement et l’assemblage fonctionnent soit depuis la chose représentée, soit depuis son point de vue. Les ruptures d’échelle et les effets de zoom (vues de détails) sont placés en décalage par rapport à l’élément photographié. Les intérieurs des bâtiments ne sont figurés que par des images de murs de cellules avec leurs graffitis, leurs peintures murales ou leurs pages de magazines. Le résultat est un éclatement de la vision, du regard et du point de vue en proposant une reconstruction imagée des lieux.
Crédits, remerciements, collaboration et partenariat
Photographies : Françoise Baussan et Frédéric Pauvarel
© Région Provence-Alpes-Côte d’Azur - Inventaire général - Françoise Baussan, 2019
© Région Provence-Alpes-Côte d’Azur - Inventaire général - Frédéric Pauvarel, 2019
L’auteur remercie les photographes, Françoise Baussan et Frédéric Pauvarel, Zoé Carle, l’Administration pénitentiaire et tout particulièrement Jérémie Billard, Thierry Lombardo et Pierre Raffin